Notre connaissance d'Henry James en France doit beaucoup à la personne de Jean Pavans, fin connaisseur et grand traducteur de cette oeuvre complexe et considérable. A travers ses traductions, ses analyses, ses adaptations théâtrales,il ne cesse d'approfondir son regard sur la pensée du grand écrivain. Il a eu la gentillesse de répondre à nos questions.

Jean Pavans: Je traduis Henry James depuis 1982. Un hasard et une nécessité m'y ont amené. J'avais avant cela publié trois ouvrages, un récit, un roman, un recueil de pastiches, aux éditions de La Différence. Le hasard, ce fut celui d'un petit article favorable déclarant qu'à me lire on sentait que j'étais influencé par Proust et par James. Proust, je m'en étais saturé; James, je n'en avais rien lu. Je me trouvais donc ainsi orienté après coup. La nécessité, ce fut celle de l'argent : on m'a fait remarquer que, pour un écrivain, traduire était un bon moyen de s'assurer des revenus décents tout en restant indépendant, ce qui était vrai il y a trente ans, étant donné le tarif au feuillet, qui n'a pratiquement pas augmenté depuis. Un ami me communique une liste de nouvelles de Henry James inédites en français. Je vais à la bibliothèque Beaubourg, où se trouve l'édition Edel de l'Intégrale des Nouvelles en douze volumes. Je lis la première phrase de la première nouvelle de ma liste, The Diary of a Man of Fifty. Je sens aussitôt que c'est fait pour moi, ou que je suis fait pour cela. Cette nouvelle devient dans ma traduction Retour à Florence, et elle donne son titre à mon premier petit recueil jamesien. J'en fais spontanément une adaptation théâtrale, qui est créée en 1985 au théâtre du Rond-Point. L'incitation et la volonté du directeur de La Différence, Joaquim Vital, ont fait que j'ai depuis lors traduit l'Intégrale des Nouvelles, et bien plus que cela. Joaquim est mort brutalement le 7 mai dernier, peu après l'achèvement de "notre" Intégrale James.
J.P: À la suite de son rude échec au théâtre, où il espérait succès artistique et gains financiers, James s'est retiré à la campagne, et a rassemblé ses forces intérieures pour approfondir son art romanesque et récapituler ses thèmes majeurs. Cela a donné, à l'aube du XXe siècle, trois chefs-d'œuvre déterminants et précurseurs : Les Ailes de la colombe, Les Ambassadeurs, la Coupe d'or. Je pense que la prédilection de James lui-même pour Les Ambassadeurs, prédilection que je partage, tient au fait qu'il y a très exactement accompli son projet. La première traduction de Georges Belmont, paraissant un demi-siècle plus tard, en plein courant du Nouveau Roman et de L'École du Regard, a certainement eu à l'époque un impact en France. Je l'avais moi-même lue avant de m'immerger dans l'original, et elle n'avait sûrement pas empêché l'œuvre de vivement me frapper. Mon objectif, au fond, a été de restituer plus fidèlement la vivacité de mon impression. En somme, je serais heureux qu'on sente la présence vivante du traducteur en tant qu'accompagnateur de la vie même du livre. J'ajouterai que je m'attache autant que possible à transmettre la vie des dialogues. Certaines particularités du Français peuvent y aider : le dosage du tutoiement, par exemple, qui n'existe pas en anglais. Cela peut paraître rudimentaire. Mais c'est beaucoup.
J.P: Antoine Jaccottet m'avait approché afin que je traduise pour lui deux courts essais de James sur Robert Browning. Cela pour moi a été l'occasion de lui dire mon envie de donner ma version de The Ambassadors, avec les annexes dont vous parlez. Ce n'était pas le premier éditeur à qui j'en parlais, mais c'est celui qui m'a suivi : c'est-à-dire, qui a été prêt à s'investir intellectuellement et financièrement. Oui, son travail éditorial est parfait. Lui-même angliciste, il a relu ma traduction avec une grande compétence et une infinie patience, et j'ai tenu compte de quelques-unes de ses remarques ponctuelles et entièrement justifiées. La préface à l'édition de 1909 avait déjà été traduite, mais le document le plus remarquable, la centaine de pages de notes préparatoires, est une nouveauté. Georges Belmont n'en avait pas eu connaissance : elles n'avaient pas été encore publiées au moment de sa traduction. Plus généralement, il ne pouvait pas posséder de James les connaissances dont nous disposons maintenant. Je ne me suis mis aux Ambassadeurs qu'au bout d'une trentaine d'années de pratique assidue de la totalité de l'œuvre, et c'est une bonne chose, je pense.
J.P: En effet, cette anecdote concernant Howells est le "germe" que James indique clairement et nommément dans ses notes et dans sa préface. Un Américain mûr, puritain, intellectuel et sensible se trouve dans une réunion mondaine à Paris, est troublé par la séduction de toute cette vie qu'il n'a pas connue et dont il s'est détourné peut-être, et il déclare alors à un jeune compatriote: "Vivez autant que vous le pouvez ; c'est une erreur de ne pas le faire". À partir de là, Howells s'estompe, le personnage de Strether apparaît, ses circonstances se présentent comme une nécessité logique, et toute l'intrigue s'épanouit splendidement selon les lois de sa propre vitalité.
J.P: J'aime le personnage de Strether. Comment ne pas aimer sa délicatesse et sa sensibilité, son intégrité, surtout, et son humour, aussi ? Mais, pour moi, la plus grande séduction du roman, ce qui m'y a le plus puissamment attiré, c'est Paris, incarnée par la subtile, touchante, et, pour reprendre votre terme, ambivalente Marie de Vionnet. Ambivalente, car, derrière son charme policé et calculé, il y a toute la violence de ses tourments intérieurs, de même que la beauté élaborée et civilisée de Paris émerge d'une histoire sanglante de guerres et de révolutions. Étant aristocrate, Marie de Vionnet habite le "noble faubourg" de la Rive gauche, plus précisément la rue de Bellechasse. Étant un américain parvenu, son jeune amant Chad Newsome habite les beaux quartiers alors récents de la Rive droite, plus précisément le boulevard Malesherbes.
J.P: Ce qui est mis en abîme dans Les Ambassadeurs, c'est le thème du Memento Mori, "n'oublie pas que tu vas mourir", indissociable du thème du Carpe Diem, "profite de l'instant", qui est l'injonction de Strether à Bilham. La jouissance à laquelle incite Paris est fondée sur une conscience de la mort.
J.P: Le suspense est celui qui se crée dans l'esprit de Strether : Quand va-t-il enfin admettre l'évidence de ce qu'il s'efforce vainement de mettre en doute, à savoir que Chad et Marie sont amants ? S'il faut vraiment définir une tension propre à la méthode de James, je dirai qu'elle tient au fait que la situation exposée, aussi claire et même crue que soit sa donnée, apparaît comme énigmatique, car elle se présente par reflet dans l'optique d'un personnage central subtil, et qu'elle est donc toute brouillée par la complexité de ses impressions, de ses sentiments, de ses réflexions.
J.P: Ce qui est curieux, c'est que James n'a pas hésité un seul instant sur le choix d'une petite ville américaine de la Côte Est intellectuelle et puritaine pour lieu d'origine de son héros, mais qu'il s'est demandé si le choix de Paris comme antithèse et lieu de perdition supposée n'était pas trop facile, évident et même vulgaire, et s'il ne valait pas mieux que ce soit Londres etc. Or Paris et ses environs sont pour nous la substance même de son roman, avec ses merveilleuses évocations du jardin des Tuileries, ou des bords de Seine aux environs de ce qu'on devine être Bougival.

J.P: Strether en effet fouine chez les bouquinistes, et il achète une Intégrale de Victor Hugo en soixante-dix volumes, dont il ne sait comment il va pouvoir les emporter !Quant à la vénération de James pour Balzac, elle tient sans doute beaucoup au fait qu'il l'ait lu adolescent. La grande révélation de la littérature romanesque, ce fut pour lui La Comédie humaine, et donc la France. Les auteurs français qui lui ont inspiré des sentiments mitigés, Zola, Maupassant, même Flaubert, étaient ses contemporains. Il avait tendance à se définir contre eux, mais cela signifie qu'il se posait essentiellement par rapport à eux, et il les a toujours lus avec un très vif intérêt. En somme, il y avait en lui une grande part de tempérament littéraire français : son souci de la réalité, dirais-je, ce que Charles Du Bos appelait "son sens prodigieux du concret".
J.P: Sans doute. Mais je dirai que ce qu'il y a de plus proustien, avant la lettre, dans Les Ambassadeurs, c'est que le récit se forme exclusivement dans la subjectivité d'un personnage central, en employant "la troisième personne", comme le fait Proust, non pas bien sûr pour la totalité de la Recherche, mais dans Un Amour de Swann. L'époque aussi est celle évoquée par Proust, et le faubourg Saint-Germain des Guermantes, et le boulevard Malesherbes où il a vécu avec ses parents.
J.P: Je vous remercie de faire ainsi allusion à une nouvelle que j'ai adaptée pour le théâtre et qui a été mise en scène par Jacques Lassalle. En effet, le jardin du palais de Juliana dans Les Papiers d'Aspern, comme le jardin de Gloriani dans Les Ambassadeurs, est le terrain des confidences et des aveux : la nature s'insinue dans la civilité, mais sous une forme apprivoisée. Le jardin des Tuileries est la frontière entre la Rive droite et la Rive gauche, et c'est donc la zone privilégiée de l'ambivalence.
J.P: Le ravissant appartement de Chad boulevard Malesherbes est celui d'un nouveau riche qui achète et collectionne avec intelligence et avec goût, goût et intelligence qu'il a acquis de sa maîtresse française d'une façon presque mystique. Dans un noble hôtel de la rue de Bellechasse, Marie de Vionnet habite au fond de la cour d'honneur un appartement à l'élégance froide et infiniment distinguée, au milieu de meubles et d'objets Empire qu'elle a hérités et qui témoignent de gloires et de désastres.
J.P: Oui, c'est l'époque où les guerres, napoléoniennes ou autres, semblaient encore cohérentes avec la civilisation, paraissaient même avoir constitué la supériorité de la civilisation européenne sur une société américaine affairiste et commerçante. Dix ans plus tard, la Première Guerre mondiale pulvérise cette apparente cohérence. James en est épouvanté : "L'effondrement de notre civilisation… un cauchemar dont on ne peut se réveiller, sauf en dormant." Il meurt en 1916, un an avant l'intervention des États-Unis, début de leur volonté, ou de leur obligation, de domination planétaire.
J.P: C'est une demande cruelle, et sans espoir. Cruelle, car c'est une façon de dire à Marie de Vionnet qu'il ne peut pas l'aimer telle qu'elle est. Et sans espoir, car il sent bien qu'à un moment donné il la verra telle qu'elle est : dissimulatrice et cherchant à le manipuler. C'est ce qui se produit lorsqu'il la surprend à la campagne avec Chad. En même temps, il est ému, mais péniblement, par la panique en elle que révèle cette dissimulation.
J.P: Maria Gostrey est amoureuse de Lambert Strether, et, dans la scène finale, il repousse ses avances, sous le prétexte fallacieux du "trop tard", cela bien sûr étant présenté avec infiniment de délicatesse, et, comme vous diriez, d'ambivalence. C'est moi qui, sans ambages, trouve odieuse Sarah Pocock. Aux yeux de Strether, elle représente plutôt, me semble-t-il, une certaine force américaine, brutale, certes, aveugle et hostile à ce qui échappe à ses principes, mais d'une certaine manière étonnante dans son orgueilleuse capacité de résistance aux séductions. Et puis elle est montrée comme assez belle, je crois. N'importe. L'Américaine qui nous plaît, c'est bien entendu la fine, drôle et désabusée, mais il est vrai européanisée, miss Gostrey
J.P: C'est aussi bien Maria Gostrey qui est le double de James, car elle est le double de Strether. Le petit paysage de Lambinet, que Strether n'avait pas osé acheter à Boston, est plus qu'une référence culturelle : il a une fonction structurelle et même morale. Le tableau, tel que se le rappelle Strether, était vide de personnages. Il en retrouve le paysage dans la réalité des bords de Seine où il surprend Chad et Marie. Alors il comprend que ce qu'il regrette de ne pas avoir eu dans sa vie, c'est non seulement le tableau, mais aussi une liaison amoureuse comme la leur, les deux regrets étant indissociables, comme le sont les charmes artistiques et bucoliques de la France et les mœurs libres françaises. Sous cet aspect, oui, Strether est le double de James. Et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle Les Ambassadeurs était son roman de prédilection.
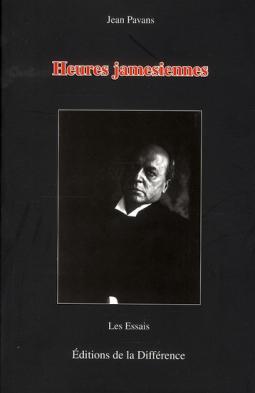
J.P: Là, pour vous répondre, il me faudrait vous faire toute une conférence. Ce que je puis vous dire en deux ou trois mots, c'est que La Source sacrée, publié en 1901, se présente comme un roman à énigme mondaine, l'énigme restant irrésolue. J'en ai fait paraître une première traduction en 1984, dans l'idée donc, idée que tout le monde partageait, d'une mondanité laissée irrésolue par plaisanterie. En 1995, dans un article parfaitement argumenté, une érudite américaine, Adeline R. Tintner, propose une clef de l'énigme, un motif précis dans le tapis : un couple d'hommes, dont le narrateur infiniment raisonneur ne décèle pas la liaison cachée. Convaincu, j'établis alors une nouvelle traduction, que je publie en 2005. La première partie de mes Heures Jamesiennes est formée de réflexions à partir ce motif-ci dans ce tapis-là.
J.P: Vous voulez dire, en français, je suppose, et à part le mien? Eh bien : Theodora Bosanquet, Henry James à l'ouvrage, Le Seuil, 2000. Leon Edel, Henry James, une vie, Le Seuil, 1990. Mona Ozouf, La Muse démocratique, Henry James ou les pouvoirs du roman, Calmann-Levy, 1998. Jean Perrot, Henry James, une écriture énigmatique, Aubier, 1982.
J.P: Après l'aventure heureuse de mon adaptation des Papiers d'Aspern, on m'avait plus ou moins proposé ou suggéré de faire une adaptation nouvelle de La Bête dans la Jungle. J'avais hésité, d'abord parce que je trouve très belle telle qu'elle est l'adaptation de Marguerite Duras, même si j'y vois des manques, qui tiennent à ma deuxième raison d'hésitation, en fait la principale, à savoir que j'estime que le théâtre, la forme simplement dialoguée, ne suffit pas pour obtenir un équivalent de la profondeur psychique de la nouvelle originale, peut-être le chef-d'œuvre le plus intime de James, et que seule l'intervention de la musique pourrait espérer y parvenir. Un hasard amical, et d'ailleurs jamesien (à l'occasion d'une représentation d'une autre de mes adaptations, L'Auteur de Beltraffio), me fait rencontrer, il y a cinq ans, un compositeur, Arnaud Petit. Nous sympathisons, je prends connaissance de sa musique, qui me plaît, je lui propose le sujet de La Bête dans la Jungle, il en est aussitôt captivé, il obtient une commande d'Etat, j'écris pour lui un livret en fonction de ses conceptions musicales, bref, la chose aboutit. Ce sera un opéra de chambre de guère plus d'une heure. Il sera créé en version de concert en fin mai 2011 au Forum du Blanc-Mesnil. On devrait le voir à Paris, à l'Athénée, et dans une mise en scène, en automne 2012. Oui, mes adaptations sont un prolongement naturel de mes traductions. Je cherche des principes de construction dramatique dans le système même de narration de la nouvelle originale, et non pas dans des règles supposées du théâtre. James, tellement libre avec la forme du roman où s'est épanoui tout son génie, croyait en des règles préétablies pour la scène, et il y a échoué. Les succès multiples de ses divers adaptateurs laissent d'autant plus songeur.
Henry James, Les Ambassadeurs, Le Bruit du Temps, 2010. (Trad Jean Pavans)
Jean Pavans, Heures Jamesiennes, La Différence, 2008.
Henry James, Les Papiers d'Aspern et sept autres nouvelles, La Différence, 2010.
Léon Edel, Henry James, Une Vie, Seuil, 2000.

Légende photo : Jérôme Garcin, Hervé Le Tellier, Rachida Brakni, Marthe Keller, Gaël Faye, Kamel Daoud, Rebecca Dautremer, Emmanuel Lepag
Avec la saison automnale, le Mois du film documentaire du Territoire de Belfort est l’occasion de se réchauffer tout en explorant une grande divers
Légende photo : Abnousse Shalmani, lauréate du prix Simone Veil 2024, entourée de Pierre-François Veil (à gauche sur la photo) et Jean Vei
 02
02
 05
05