
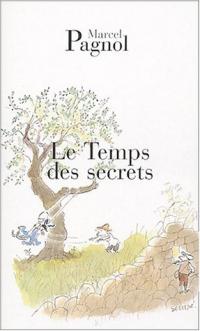
Après la terrible affaire du Château, si glorieusement terminée par la victoire de Bouzigue, la joie s’installa dans la petite Bastide-Neuve, et les grandes vacances commencèrent.
Cependant, la première journée ne fut pas celle que j’avais vécue par avance avec tant de frémissante joie : Lili ne vint pas m’appeler à l’aube, comme il me l’avait promis, et je dormis profondément jusqu’à huit heures.
Ce fut le tendre crissement d’un rabot qui me réveilla.
Je descendis en hâte aux informations.
Je trouvai mon père sur la terrasse : il redressait l’équerre d’une porte gonflée par l’hiver, et des copeaux en crosse d’évêque montaient s’enrouler jusque sous son menton.
Tout à son ouvrage, il me montra du doigt une feuille de papier suspendue par un brin de raphia à la basse branche du figuier : je reconnus l’écriture et l’orthographe de mon cher Lili.
ce matin on peux pas aller aux piège, je suis été avec mon Père pour la Moison au chant de Pastan. Viens, on manje sous les pruniers. viens. te prèse pas. on nié tout le jour. ton ami Lili Ya le mullet Tu pourras monté dessur. viens. ton ami Lili. Cet le chant des becfigue de l’an pasé, viens.
Ma mère, qui venait de descendre à son tour, chantait déjà dans la cuisine.
Pendant que je savourais mon café au lait, elle prépara ma musette : pain, beurre, saucisson, pâté, deux côtelettes crues, quatre bananes, une assiette, une fourchette, un verre, et du sel dans un nœud de roseau, bouché par un gland de kermès.
La musette à l’épaule, et mon bâton à la main, je partis tout seul vers les collines enchantées.
Pour aller au « champ des becfigues », je n’avais qu’à traverser le petit plateau des Bellons et à descendre dans le vallon : en remontant le fond de la faille, je pouvais arriver au champ perdu en moins d’une heure. Mais je décidai de faire un détour par les crêtes, en passant sur l’épaule de la Tête-Ronde, dont la noire pinède terminale, au-dessus de trois bandeaux de roche blanche, se dressait dans le ciel du matin.
Le puissant soleil de juillet faisait grésiller les cigales : sur le bord du chemin muletier, des toiles d’araignées brillaient entre les genêts. En montant lentement vers le jas de Baptiste, je posais mes sandales dans mes pas de l’année dernière, et le paysage me reconnaissait.
Au tournant de Redouneou, deux alouettes huppées, aussi grosses que des merles, jaillirent d’un térébinthe : j’épaulai mon bâton, je pris mon temps (comme l’oncle Jules), et je criai : « Pan ! Pan ! » Je décidai que j’avais tué la première, mais que j’avais tiré trop bas pour la seconde et j’en fus navré.
La vieille bergerie avait perdu la moitié de son toit ; mais contre le mur en ruine, le figuier n’avait pas changé : au-dessus de sa verte couronne, la haute branche morte se dressait toujours, toute noire contre l’azur.
Je serrai le tronc dans mes bras, sous le bourdonnement des abeilles qui suçaient le miel des figues ridées, et je baisai sa peau d’éléphant en murmurant des mots d’amitié.
µPuis je suivis la longue « barre » qui dominait la plaine en pente de La Garette… Sur le bord de l’à-pic, je retrouvai les petits tas de pierres que j’avais construits de mes mains pour attirer les culs-blancs, ou les alouettes des montagnes… C’est au pied de ces perchoirs que nous placions nos pièges l’année précédente, c’est-à-dire au temps jadis…
Lorsque j’arrivai au pied du chapiteau du Taoumé, j’allai m’asseoir sous le grand pin oblique, et je regardai longuement le paysage.
Au loin, très loin, sur ma droite, au-delà de collines plus basses, la mer matinale brillait.
Devant moi, au pied de la chaîne de Marseille-Veyre, nue et blanche comme une sierra, des brumes légères flottaient sur la longue vallée de l’Huveaune…
Enfin, à ma gauche, la haute barre feuilletée du Plan de l’Aigle soutenait l’immense plateau qui montait, par une pente douce, jusqu’à la nuque de Garlaban.
Une brise légère venait de se lever : elle attisa soudain le parfum du thym et des lavandes. Appuyé sur mes mains posées derrière moi, le buste penché en arrière, je respirais, les yeux fermés, l’odeur brûlante de ma patrie, lorsque je sentis sous ma paume, à travers le tapis de ramilles de pin, quelque chose de dur qui n’était pas une pierre. Je grattai le sol, et je mis au jour un piège de laiton, un piège à grives tout noir de rouille : sans doute l’un de ceux que nous avions perdus le jour de l’orage, à la fin des vacances… Je le regardai longuement, aussi ému que l’archéologue qui découvre au fond d’une fouille le miroir éteint d’une reine morte… Il était donc resté là toute une année, sous les petites aiguilles sèches qui étaient tombées lentement sur lui, l’une après l’autre, pendant que les jours tombaient sur moi… Il avait dû se croire perdu à jamais…
Je le baisai, puis je l’ouvris. Il me sembla que le ressort avait gardé toute sa force. Alors, je le frottai contre la terre : un mince fil d’or reparut, et je vis qu’il serait facile de le ressusciter : je me levai, je le mis dans ma musette, et je descendis au galop vers Passe-Temps, où m’attendait Lili le Moissonneur. »