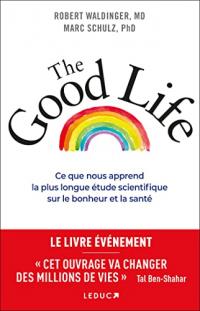
Chapitre 1. Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
Commençons par une question. Si vous deviez faire un seul choix de vie, dès maintenant, pour vous engager sur la voie de la santé et du bonheur, quel serait-il ? Choisiriez-vous de mettre un peu plus d’argent de côté tous les mois ? De changer de métier ? Décideriez-vous de voyager davantage ? Quel choix pourrait vous garantir que lorsque, à un âge avancé, vous regarderez en arrière, vous aurez le sentiment d’avoir réussi votre vie ?
Dans une enquête réalisée aux États-Unis en 2007, on a interrogé des millenials sur leurs principaux objectifs2 : 73 % d’entre eux souhaitaient devenir riches, 50 % espéraient devenir célèbres. Une dizaine d’années plus tard, alors qu’ils avaient passé plus de temps à l’âge adulte, on leur a posé les mêmes questions, dans le cadre de deux autres enquêtes. La célébrité figurait désormais en bas de la liste, mais dans leurs principaux objectifs on retrouvait : gagner de l’argent, réussir sa vie professionnelle et ne plus avoir de dettes.
Ce sont des objectifs pratiques, qui transcendent les générations et les frontières. Dans de nombreux pays, à peine sont-ils en âge de parler qu’on demande aux enfants ce qu’ils veulent faire quand ils seront grands, c’est-à-dire dans quelles carrières ils ont l’intention de s’engager. Une fois adulte, lorsqu’on rencontre quelqu’un, l’une des premières questions qu’on lui pose porte sur son métier. La réussite dans la vie est souvent mesurée par le titre, le salaire et les réalisations professionnelles. Bien sûr, nous savons tous que cela ne suffit pas à définir une vie heureuse. Ceux qui parviennent à cocher certaines, voire toutes les cases se retrouvent souvent de l’autre côté du miroir, avec le même sentiment qu’avant Pendant ce temps, nous sommes bombardés de messages sur ce qui nous rendra heureux, sur ce que nous devrions souhaiter dans la vie, sur ce qui fait une « bonne » vie.
Les publicités nous disent qu’en mangeant un yaourt de telle marque nous serons en bonne santé, qu’acheter tel smartphone nous mettra de la joie au cœur et qu’utiliser telle crème de nuit nous apportera la jeunesse éternelle. D’autres messages, moins explicites, imprègnent le tissu de la vie quotidienne. Si un ami achète une nouvelle voiture, nous nous demandons si nous n’aurions pas, nous aussi, besoin d’une voiture plus récente. Lorsque nous parcourons les fils des réseaux sociaux, ne voyant que des photos de fêtes fantastiques et de plages de sable fin, nous nous demandons où sont les fêtes et les plages dans notre vie.
Dans nos amitiés occasionnelles, au travail et surtout sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à nous montrer mutuellement des versions idéalisées de nous-mêmes. Chacun se présente sous son meilleur jour, et la comparaison entre ce que nous voyons de l’autre et ce que nous ressentons pour nous-mêmes nous donne l’impression de passer à côté de quelque chose. Nous comparons constamment ce que nous vivons intérieurement avec ce que les autres veulent bien nous montrer. Avec le temps, nous développons le sentiment subtil mais tenace que notre vie est ici et maintenant, alors que les choses qui nous rendraient heureux sont ailleurs ou plus tard. Toujours hors de portée. En regardant à travers cette lentille, il est facile de croire qu’une belle vie n’existe pas vraiment, ou alors qu’elle est réservée aux autres.
Notre propre existence, après tout, correspond rarement à l’image que nous nous en sommes formée. Elle est toujours trop désordonnée, trop compliquée pour être réussie. Spoiler alert : une vie réussie, c’est une vie compliquée. Pour tout le monde. C’est une vie joyeuse… et difficile. Pleine d’amour, mais aussi de douleur. Et elle ne se produit jamais de façon absolue ; au contraire, une vie réussie se déploie au fil du temps. C’est un processus* . Elle comprend des tourments, du calme, de la légèreté, du stress, des difficultés, des réussites, des revers, des bonds en avant et des chutes terribles. Et bien sûr, elle se termine toujours par la mort. Ce n’est pas très gai ? On peut voir les choses autrement. La vie, certes, n’est pas facile. Et il n’y a tout simplement aucun moyen de la rendre parfaite. Mais si c’était le cas, on ne pourrait pas vraiment parler d’une vie réussie. Pourquoi ? Parce qu’une vie riche, une vie vraiment réussie, se forge précisément à partir de ce qui la rend difficile.
Ce livre s’appuie sur un socle de recherche scientifique, au centre duquel figure l’étude de Harvard sur le développement des adultes, un extraordinaire projet scientifique lancé en 1938 et qui, contre toute attente, se poursuit encore aujourd’hui. Bob est le quatrième directeur de ce programme, Marc est son directeur associé. Radicale pour l’époque, l’étude visait à comprendre la santé humaine en étudiant non pas ce qui rendait les gens malades, mais pourquoi ils allaient bien. L’étude a enregistré l’expérience de vie de ses participants, plus ou moins telle qu’elle se déroulait, des problèmes de l’enfance à ceux des derniers jours, en passant par les premières amours. À l’instar de la vie de ses participants, l’étude de Harvard a elle-même connu une existence longue et sinueuse. Ses méthodes ont évolué au fil des décennies et elle s’est élargie pour inclure aujourd’hui trois générations et plus de 1300 descendants des 724 participants initiaux. Elle continue d’évoluer et de s’étendre, et constitue à ce jour la plus longue étude longitudinale approfondie de la vie humaine jamais réalisée. Mais aucune étude, aussi riche soit-elle, ne saurait suffire à proclamer de grandes vérités sur l’existence. C’est pourquoi, bien que ce livre se fonde directement sur l’étude de Harvard, nous nous sommes appuyés sur des centaines d’autres travaux scientifiques, impliquant des milliers de personnes dans le monde entier. Ce livre est également empreint de la sagesse d’un passé récent et ancien, des idées éprouvées par le temps, qui reflètent et enrichissent la compréhension scientifique moderne de l’expérience humaine. Il s’agit fondamentalement d’un livre sur le pouvoir des relations, et il est profondément influencé, comme il se doit, par la longue et fructueuse amitié qui unit ses auteurs. Mais ce livre n’existerait pas sans les hommes et les femmes qui ont participé à l’étude de Harvard, des gens dont l’honnêteté et la générosité ont permis de mener à bien ce projet improbable. Des gens comme Rosa et Henry Keane.
« Quelle est votre plus grande peur ? » Rosa avait lu la question à haute voix, puis elle avait regardé son mari, Henry, assis en face d’elle à la table de la cuisine. À présent septuagénaires, Rosa et Henry vivaient dans cette maison depuis plus de cinquante ans. Presque tous les matins, pendant ces cinq décennies, ils s’étaient assis à cette même table. Entre eux se trouvaient une théière, un paquet d’Oreo à moitié entamé et un dictaphone. Dans un coin de la pièce, une caméra. À côté de la caméra était assise une jeune enquêtrice de Harvard nommée Charlotte, qui observait silencieusement en prenant des notes. « C’est une sacrée question, remarqua Rosa.
— Ma plus grande peur ? demanda Henry à Charlotte. Ou notre plus grande peur ? »
Rosa et Henry ne se considéraient pas comme des sujets d’étude particulièrement intéressants. Ils avaient tous deux grandi dans un milieu très modeste, s’étaient mariés jeunes et avaient élevé cinq enfants. Ils avaient traversé la Grande Dépression et de nombreuses périodes difficiles, certes, mais ils n’étaient pas différents des autres personnes qu’ils connaissaient. Ils n’avaient donc jamais compris pourquoi les chercheurs de Harvard s’intéressaient à eux, et encore moins pourquoi ils continuaient à le faire, à téléphoner, à envoyer des questionnaires et, parfois, à traverser le pays en avion pour leur rendre visite. Henry n’avait que 14 ans et vivait dans le West End de Boston, dans un immeuble sans eau courante, lorsque les chercheurs de l’étude avaient frappé pour la première fois à sa porte et avaient demandé à ses parents perplexes s’ils pouvaient enregistrer sa vie. Lorsqu’il avait épousé Rosa, en août 1954, l’étude battait son plein (les archives montrent que lorsqu’elle a accepté sa demande en mariage, Henry n’arrivait pas à y croire) et les voilà en octobre 2004, deux mois après leur cinquantième anniversaire de mariage.
En 2002, on avait demandé à Rosa de participer plus directement à l’étude. Il était temps, avait-elle remarqué ! Harvard suivait Henry année après année depuis 1941. Rosa trouvait étrange qu’il accepte encore de participer à l’étude alors qu’il était déjà un vieil homme, lui si discret par ailleurs. Mais Henry se sentait obligé de participer et disait aussi qu’il avait appris à apprécier le processus parce qu’il lui permettait de voir les choses sous un autre angle. Ainsi, pendant soixante-trois ans, il avait ouvert sa vie aux chercheurs. En fait, il leur avait tellement parlé de lui, et pendant si longtemps, qu’il ne se souvenait même plus de ce qu’ils savaient ou non. Mais il supposait qu’ils savaient tout, y compris certaines choses qu’il n’avait dites à personne d’autre que Rosa, car chaque fois qu’ils posaient une question, il faisait de son mieux pour leur dire la vérité. Et ils posaient beaucoup de questions. « M.Keane était manifestement flatté que je sois venue à Grand Rapids pour les interviewer, écrivit Charlotte dans ses notes de terrain, et cela a créé une atmosphère amicale pour l’entretien. J’ai trouvé en lui une personne coopérative et intéressée. Il réfléchissait à chaque réponse et s’arrêtait souvent quelques instants avant de l’exprimer. Il s’est montré amical et il m’a fait l’impression de correspondre au stéréotype de l’homme tranquille du Michigan. »
Charlotte était venue passer deux jours pour interviewer les Keane et leur faire remplir un questionnaire – un très long questionnaire – sur leur santé, leur vie personnelle et leur vie commune. Comme la plupart de nos jeunes chercheurs en début de carrière, Charlotte se posait des questions sur ce que c’est qu’une vie réussie et sur la manière dont ses propres choix pouvaient influencer son avenir. Était-il possible que la vie des autres renferme des informations sur la sienne ? La seule façon de le savoir était de poser des questions et de consacrer toute son attention à chaque personne qu’elle interrogeait. Qu’est-ce qui comptait pour cette personne en particulier ? Qu’est-ce qui donnait un sens à ses journées ? Qu’avait-elle appris de ses expériences ? Que regrettait-elle ? Chaque entretien offrait à Charlotte de nouvelles opportunités d’entrer en contact avec quelqu’un dont la vie était plus avancée que la sienne, qui avait connu des circonstances différentes et une autre époque. Aujourd’hui, elle allait interroger Henry et Rosa, leur faire remplir le questionnaire, puis les filmer en train d’évoquer leurs plus grandes peurs. Elle les interrogerait également séparément, dans le cadre de ce que nous appelons les « entretiens attachés ». De retour à Boston, les cassettes vidéo et les transcriptions des entretiens seraient étudiées afin que la façon dont les participants parlaient l’un de l’autre, leurs signaux non verbaux et bien d’autres informations puissent être codés en données sur la nature de leur relation – des données qui intégreraient leurs dossiers et formeraient un élément infime mais important d’un gigantesque ensemble de données sur ce qu’est réellement une vie.
Quelle est votre plus grande peur ? Charlotte avait déjà enregistré leurs réponses individuelles à cette question dans des entretiens séparés, mais il était maintenant temps qu’ils en discutent ensemble. Voici comment s’est déroulée la conversation. « D’une certaine manière, j’aime les questions difficiles, nota Rosa. — Bien, dit Henry. Tu commences. » Elle resta un moment silencieuse, avant de dire à son mari que sa plus grande peur, c’était qu’il connaisse un grave problème de santé, ou qu’il ait une nouvelle attaque. Henry en convenait, cela lui faisait peur à lui aussi. Mais, remarqua-t-il, ils arrivaient à un point où de toute façon quelque chose de ce genre finirait par se produire. Ils discutèrent longuement de la façon dont une maladie grave pourrait affecter la vie de leurs enfants adultes, et les affecter l’un l’autre. Rosa finit par admettre qu’on ne pouvait pas tout prévoir et qu’il ne servait à rien de s’énerver avant que les choses arrivent. « Avez-vous une autre question ? demanda Henry à Charlotte.
— Quelle est ta plus grande peur, Hank ? répliqua Rosa.
— J’espérais que vous oublieriez de me le demander.» Ils rirent. Henry versa encore un peu de thé à Rosa, reprit un Oreo, puis resta un moment silencieux. « Cette question n’est pas si difficile, finit-il par dire. C’est juste que ce n’est pas le genre de choses auxquelles j’aime penser, pour être honnête. — Eh bien, cette jeune fille a fait tout le trajet depuis Boston, alors tu ferais mieux de répondre.
— C’est moche, j’en ai peur, dit-il, la voix hésitante. —Vas-y. — Que tu meures avant moi, voilà ma crainte. Que je reste ici sans toi. » À l’angle du Bulfinch Triangle dans le West End de Boston, non loin de l’endroit où Henry Keane a passé son enfance, le Lockhart Building surplombe le carrefour animé de Merrimac Street et Causeway Street. Au début du xxe siècle, cette structure en brique était une usine de meubles où travaillaient des hommes et des femmes du quartier d’Henry.
Aujourd’hui, l’immeuble est toujours là, mais on y trouve des cabinets médicaux, une pizzeria et une boutique de donuts. Il abrite également les chercheurs et les archives de la fameuse étude de Harvard sur le développement des adultes, la plus longue jamais réalisée sur le sujet. Nichés au fond d’un tiroir étiqueté « KA-KE », se trouvent les dossiers d’Henry et de Rosa. À l’intérieur figurent les pages jaunies, aux bords effrités, du premier entretien avec Henry en 1941. Il est rédigé à la main, dans une écriture cursive fluide et bien lisible. Nous voyons que sa famille était parmi les plus pauvres de Boston, qu’à l’âge de 14 ans Henry était considéré comme un adolescent « stable, bien contrôlé », portant « un regard sensé sur son avenir ». Nous y lisons qu’un peu plus tard, jeune adulte, il était très proche de sa mère, mais qu’il en voulait à son père, dont l’alcoolisme avait obligé le jeune homme à devenir le principal soutien de famille. Lors d’un incident particulièrement dommageable, alors qu’Henry avait une vingtaine d’années, son père avait dit à la nouvelle fiancée d’Henry que sa bague de fiançailles à 300 dollars les avait privés d’une somme précieuse pour la famille. Craignant de ne jamais parvenir à échapper à cette famille, la jeune femme avait rompu les fiançailles.
En 1953, Henry parvint à se libérer de son père grâce à un emploi chez General Motors. Il déménagea à Willow Run, dans le Michigan. C’est là qu’il rencontra Rosa, issue d’une famille d’immigrés danois qui comptait neuf enfants. Un an plus tard, ils se marièrent, puis eurent cinq enfants. « Beaucoup, mais pas assez », si l’on en croit Rosa.
Au cours de la décennie suivante, Henry et Rosa connurent des moments difficiles. En 1959, leur fils de 5 ans, Robert, contracta la polio, ce qui mit leur couple à l’épreuve et causa beaucoup de douleur et d’inquiétude dans la famille. Henry avait commencé chez GM comme assembleur mais, après avoir manqué le travail à cause de la maladie de Robert, il fut rétrogradé, puis licencié et se retrouva au chômage avec trois enfants à charge. Afin de joindre les deux bouts, Rosa trouva un emploi pour la municipalité de Willow Run, au service de la paie. Ce n’était au départ qu’un pis-aller pour la famille, mais Rosa était très appréciée de ses collègues et y travailla à plein temps pendant les trente années suivantes, nouant des relations avec des personnes qu’elle finit par considérer comme sa deuxième famille. Après son licenciement, Henry changea trois fois d’emploi, pour finalement revenir en 1963 chez GM, où il gravit les échelons jusqu’au poste de chef d’atelier.
Peu de temps après, il reprit contact avec son père (qui avait réussi à surmonter sa dépendance à l’alcool) et lui pardonna. Peggy, la fille d’Henry et Rosa, aujourd’hui âgée d’une cinquantaine d’années, participe également à l’étude. Elle ne sait pas ce que ses parents ont raconté aux chercheurs, car nous ne voulons pas biaiser ce qu’elle nous dit de sa vie familiale. Avoir plusieurs points de vue sur le même environnement familial et les mêmes événements permet d’élargir et d’approfondir les données de l’étude. Le dossier de Peggy nous apprend qu’en grandissant, elle avait l’impression que ses parents comprenaient ses problèmes et qu’ils l’aidaient à retrouver le moral lorsqu’elle était contrariée. De façon générale, elle considérait ses parents comme « très affectueux ». Et conformément aux déclarations d’Henry et de Rosa au sujet de leur mariage, elle confirmait que ses parents n’avaient jamais envisagé la séparation ou le divorce.(....) »