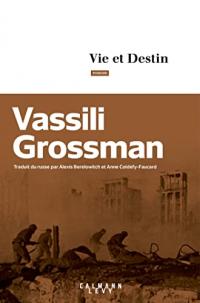
Le brouillard recouvrait la terre. Les phares de la voiture se reflétaient dans les lignes à haute tension qui s’étiraient le long de la route.
Il n’avait pas plu mais, à l’aube, l’humidité s’abattit sur la terre et les feux dessinèrent des taches rougeâtres sur l’asphalte mouillé. On sentait la respiration du camp à de nombreux kilomètres : les fils électriques, les routes, les voies de chemin de fer se dirigeaient tous vers lui, toujours plus denses. C’était un espace rempli de lignes droites, un espace de rectangles et de parallélogrammes qui fendaient la terre, le ciel automnal, le brouillard.
Des sirènes lointaines poussèrent un hurlement doux et plaintif.
La route venait se serrer contre les rails, et la colonne de camions chargés de sacs de ciment roula un certain temps à la hauteur du train de marchandises interminable. Les chauffeurs en uniforme ne regardaient pas les wagons, les taches pâles des visages.
La clôture du camp sortit du brouillard : des rangs de barbelés tendus sur des poteaux en béton. Les alignements de baraques formaient des rues larges et rectilignes. Leur uniformité exprimait le caractère inhumain du camp.
Parmi les millions d’isbas russes, il n’y a et il ne peut y avoir deux isbas parfaitement semblables. Toute vie est inimitable. L’identité de deux êtres humains, de deux buissons d’églantines est impensable… La vie devient impossible quand on efface par la force les différences et les particularités.
L’œil rapide mais attentif du vieux machiniste suivait le défilement des poteaux de béton, des grands mâts surmontés de projecteurs pivotants, des miradors au sommet desquels on voyait, derrière les vitres, les sentinelles auprès des mitrailleuses. Le mécanicien fit un signe à son aide et la locomotive lança un coup de sifflet d’avertissement. Ils entrevirent une guérite brillamment éclairée, une file de camions arrêtés par la barrière baissée du passage à niveau, l’œil rouge du feu clignotant.
Ils entendirent les sifflets d’un convoi qui venait à leur rencontre. Le mécanicien se tourna vers son aide.
— C’est Zucker, je le reconnais à sa voix effrontée, il a livré la marchandise et file à vide vers Munich.
Le convoi croisa dans un bruit assourdissant celui qui, chargé, allait vers le camp, l’air déchiré criait, les lumières grises entre les wagons se succédaient, et soudain l’espace et la lumière grise de l’automne déchiqueté en lambeaux se réunirent à nouveau en une voie qui filait régulièrement.
L’aide-mécanicien sortit une petite glace de poche et examina sa joue salie. Le mécanicien la lui demanda d’un mouvement de la main.
Son aide dit d’une voix tendue :
— Ah ! Genosse Apfel, croyez-moi, nous aurions pu rentrer pour le dîner au lieu de rester jusqu’à 4 heures du matin, en y laissant nos dernières forces, s’il n’y avait pas cette maudite désinfection des wagons. Comme s’il n’était pas possible de l’effectuer chez nous, au dépôt. ( Début du Chapitre 1)