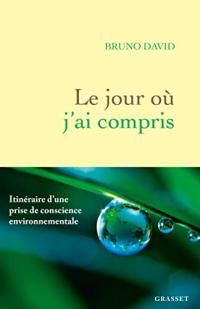
Enfance (1960)
Je suis né à Lyon et j’ai passé mon enfance, et même un peu plus, dans un quartier périphérique de cette métropole, aux confins orientaux de Villeurbanne, dans un environnement cosmopolite avec encore un pied dans le passé – un chemin creux bordé d’arbres où je faisais du vélo, des trottoirs en terre, le champ de mes grands-parents paternels, maraîchers en retraite –, et l’autre pied dans le présent – immeubles en construction, destruction des vieilles maisons en pisé…
Enfant dans les années 1960, j’ai eu la chance de grandir dans une famille de naturalistes sensibles aux sujets d’environnement : hors de question de se débarrasser d’un papier par la fenêtre de la voiture, une Panhard rouge sombre, hors de question de laisser traîner des restes de pique-nique. Ces quelques mots témoignent que le souci environnemental de l’époque – quand il y en avait un, ce qui était très rare – était clairement la pollution et presque uniquement la pollution.
Il faut dire que, dans la France des Trente Glorieuses, nos parents étaient fiers de nous montrer à quel point l’agriculture se modernisait, à quel point les routes devenaient plus larges, à quel point des bidonvilles laissaient la place à des cités de béton qui sortaient de terre à grand renfort de main-d’œuvre immigrée. Je me rappelle d’ailleurs avoir regardé brûler, depuis l’autre côté du « boulevard de ceinture » qui entoure Lyon à l’est, le bidonville qui étalait sa misère à 500 mètres du domicile de mes parents. Des logements en dur, quoique provisoires, et des barres flambant neuves avaient été dressés un peu plus au sud, vers Bron, pour remplacer les baraquements en bois et en tôle. La question de l’emprise du béton ou du goudron sur les territoires naturels n’était pas à l’ordre du jour, le « progrès » primait sur tout et il était beau par définition.
Pourtant, à Lyon, les jours de vent du Midi, le progrès avait une odeur, celle du couloir de la chimie qui s’étendait le long du Rhône au sud de sa confluence avec la Saône. Les usines de Rhône-Poulenc (textile et pharmacie), de Ciba (chimie), de Berliet (camions) et à peine plus loin la raffinerie de Feyzin tournaient à plein régime, émettant fumées et vapeurs sans filtre. La pollution se reniflait et j’ai encore en mémoire, plus de cinquante ans après, l’exact « parfum » de ces journées où le vent n’était pas favorable. Dit clairement, pas favorable pour évacuer ces miasmes dans une autre direction, vers d’autres populations.
Comment alors ne pas être sensibilisé, oserais-je dire éveillé, à ces questions de pollution, dès lors que vos narines enfantines la détectent ? Ma sensibilisation, voire ma détestation de ces pollueurs de mon air, était exacerbée par les propos de mon père, tenus certains soirs où le repas se prenait en retard ou commençait sans lui. Ce père naturaliste était géologue, professeur à l’université alors installée sur les quais du Rhône. À ce titre de scientifique, il était membre du Conseil d’hygiène du département du Rhône, qui se réunissait plusieurs fois par an à la Préfecture. Je me souviens de la question traditionnelle de ma mère l’accueillant d’un : « Alors, comment cela s’est passé cette fois ? » et de la réponse sensiblement la même de mon père « les nerfs en boule », comme il aimait à le dire, et las de voir l’histoire se répéter : « Ces foutus chimistes et industriels ne comprendront jamais que leurs effluves (dans l’air) et leurs effluents (dans l’eau du Rhône) présentent des niveaux de pollutions inacceptables ; ce sont des pollueurs et en plus des fourbes. » Je me souviens fort bien du soir où il a décrit les ruses employées pour déverser plus en aval les produits toxiques ou réduire l’activité des usines les jours de contrôle, qui étaient connus à l’avance. Eh oui, déjà à l’époque !
Je m’attarde sur la pollution car, dans les années 1960, c’était l’unique sujet de préoccupation pour les rares personnes ayant une sensibilité écologique, et que des faits sans rapport apparent les uns avec les autres ont laissé leur trace dans ma mémoire d’enfant. Attention, n’y voyez aucun traumatisme, simplement des petites touches de sensibilisation, quasiment à mon insu.
Transportons-nous dans le Massif central. Vers l’amont, à quelques kilomètres de sa source, la Loire est encore une rivière à moitié sauvage, alternant zones calmes et petits rapides. Qu’elle était belle la rivière de mon enfance, celle de l’été finissant lorsque, la rentrée des classes arrivant seulement fin septembre, je passais une dizaine de jours chez mes grands-parents maternels en Haute-Loire, dans le petit village de Lavoûte-sur-Loire. Image bucolique d’un parangon de village avec sa rivière, son pont, son château assis sur un piton de granite, sa petite église romane, son monument aux morts avec ses quatre obus dressés, le tout planté dans un paysage de forêts et de bocages. Vie simple de l’époque, avec un confort rudimentaire : pas de salle de bains, des toilettes à la turque sans chasse d’eau au fond de la cour et, encore plus surprenant, impensable depuis longtemps : pas de ramassage des ordures.
À la nuit tombée, car il fallait rester discret et digne, tout le village se croisait furtivement sur le pont qui enjambait la Loire et, hop, les petits seaux à ordure déversaient leur contenu dans la rivière. Ces seaux ne contenaient pas grand-chose, quelques noyaux ou épluchures emballés dans une page de journal, aucun plastique, aucun bocal ou bouteille, rien que du papier et de l’organique et encore, pas tous les jours. Accompagner mon grand-père la nuit était un divertissement dans lequel je ne voyais aucun mal : le pont était en aval du village et les poissons se chargeaient du nettoyage. La Loire était brave au point d’accepter nos déchets ménagers et même pire, car il n’existait pas de collecteur des eaux usées ni de station d’épuration.
Vie simple et loisirs simples, dont les parties de pêche en bord de Loire. Je ne faisais que le pressentir, comment faire plus quand on a sept ans, mais la Loire n’était pas resplendissante. Nos cannes en bambou se déployaient en amont du village et nous ne rentrions jamais sans de quoi faire une petite friture de vairons et de goujons. À ce jeu ma grand-mère était la plus forte. Seule ombre au tableau, la belle rivière d’allure encore sauvage au sortir des gorges qui viennent du Puy-en-Velay charriait régulièrement quelques paquets de mousse brunâtre tout droit venus des Tanneries du Puy, dix kilomètres en amont. Ces tanneries étaient une fierté locale installée à Chadrac, commune jouxtant Le Puy, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à moins de 100 mètres de la Loire. Proximité bien commode4 ! Jamais l’idée ne m’a traversé l’esprit que les poissons consommés le soir auraient pu être quelque peu chargés en chrome. Mon grand-père grognait par principe contre cette mousse et nous parlait de la Loire de son enfance, si propre, mais après tout, jamais personne n’était malade. En 2021, une enquête de Santé publique France révélait que tous les Français, enfants compris, étaient contaminés aux métaux lourds. Maintenant, je sais d’où vient une partie de ma dose.
Ces parties de pêche à la ligne auraient pu me faire rencontrer ma première espèce invasive mais c’est mon frère qui y a été confronté le premier. Je devais avoir une dizaine d’années et c’était au tour de mon petit frère de passer une semaine en Haute-Loire, tandis que je restais à Lyon. Mes parents reçoivent la traditionnelle carte postale – il faut dire que le téléphone n’était pas encore installé dans la maison de Villeurbanne et encore moins à Lavoûte – et là, le choc. Mon frère a attrapé une petite perche, mais en plus c’est une perche-soleil. Un double exploit, digne des bartavelles de Marcel Pagnol, un exploit qui m’est resté en mémoire car j’en étais à la fois jaloux et fier pour mon frère. Depuis, j’ai appris que derrière ce joli nom se cachait une espèce américaine introduite en Europe au XIXe siècle et que le Code de l’environnement impose d’occire en cas de capture. Celle de mon frère fut pêchée avant que cette obligation ne voie le jour et de toute manière, elle a fini frite ! Quoi qu’il en soit, à l’époque, cela ne préoccupait personne, un poisson restait un poisson et la notion d’espèce invasive n’avait pas émergé. Tout au plus pensions-nous au phylloxéra qui était plutôt connu comme ravageur que comme envahisseur venu d'Amérique. »