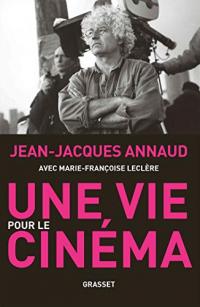
Naissance d’une passion
Je suis né à l’hôpital de Juvisy-sur-Orge le 1er octobre 1943 et j’ai grandi à Draveil (Essonne), dans la banlieue de Paris. J’étais le fils unique, tardif et précieux de Pierre, employé aux chemins de fer, et de Madeleine, secrétaire de direction. Nous vivions dans un pavillon à soubassement de meulières – très important le soubassement ! –, et le sous-sol, qui était mon domaine, ouvrait sur un jardin. Tout cela modeste, calme, bien rangé, un peu gris, c’était l’après-guerre en banlieue.
J’étais un enfant solitaire, paisible, curieux, acharné quand quelque chose me passionnait. Par exemple, l’annuaire des chemins de fer. Le métier de mon père lui offrant des facilités pour voyager en train, dès que nous avions trois jours de liberté, nous partions. Nous avons sillonné la France et, à chaque fois, j’étudiais les itinéraires, les horaires, les changements, j’étais incollable ! Bientôt ça ne m’a plus suffi et je me suis mis à constituer des dossiers sur les endroits visités avec des photos découpées dans des magazines et, dès l’âge de 7 ans, avec les miennes. Il y avait des aperçus géologiques, géographiques, historiques… en somme, je faisais déjà des repérages !
Pour l’anniversaire de mes 7 ans, on m’avait offert un Browning mais je ne l’utilisais qu’avec parcimonie – la pellicule était chère. Au point qu’un jour où ma mère me demandait de les photographier, elle et mon père, j’ai répondu : « Non, je ne photographie que ce qui est beau ! » Sur le coup, ils ont beaucoup ri, ensuite ils ont insisté, mais je n’ai pas cédé. Jamais. Ils ne prétendaient quand même pas rivaliser avec l’église de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), le premier « sujet » de « L’inventaire Général des Églises peu connues de France » dans lequel je m’étais lancé ! Et je vous passe les fresques de Saint-Savin et les calvaires bretons !
L’art magique du cousin René
Le cinéma est arrivé très tôt dans cet univers. La cérémonie avait lieu le dimanche, au Draveil Palace. Un enchantement. Mais ma véritable attirance pour le septième art est née chez le cousin René. Fabuleux personnage, le modèle et, en même temps, la terreur de mon enfance. Fils d’un chaudronnier et d’une institutrice, la sœur aînée de ma mère, il avait été reçu à Polytechnique, à Centrale et aux Mines. Il avait choisi Centrale et opté pour l’aéronautique. Ma mère, qui était en compétition avec sa sœur, voulait absolument que son Jean-Jacques en fasse autant, et même plus. Elle ne tolérait pas que je sois deuxième en classe : je devais être meilleur que le cousin René ! Or ce cousin voyageait beaucoup, en Super-Constellation s’il vous plaît, et il s’était acheté une caméra Paillard, le fin du fin du 8 mm. Quand nous allions chez eux, deux fois par an, on fermait les rideaux et il y avait projection. Je me souviens encore d’un Été indien au Québec avec les feuilles jaunissantes qui m’avait stupéfié. Imaginez les rêves d’un gamin de cette époque, de ce milieu, face à un cousin qui revenait de pays lointains et qui savait faire ces trucs magiques que je voyais au Draveil Palace !
Du côté de mon père, mon autre cousin, Jean-Pierre Annaud, avait reçu pour ses 15 ans une caméra Pathé 9,5 mm et lui aussi réalisait de petits films. Mon étonnement a redoublé. Peu à peu, je prenais conscience de ce que le cinéma n’était pas de l’ordre de l’irréel.
L’illumination s’est produite l’année de mes 8 ans, un jeudi. Mon père était abonné à La Vie du rail et moi au Journal de Mickey dans lequel je vénérais l’adaptation en bande dessinée et quadrichromie de La Guerre du feu. Ce matin-là donc, le facteur dépose dans la boîte aux lettres mon Mickey et une grande enveloppe jaune contenant le catalogue annuel d’Odéon-Photo, un des meilleurs magasins de photo parisiens, où ma mère avait débuté. Avant même de lire Mickey, je regarde ce catalogue, et que vois-je à la fin ? Les merveilleuses machines de mes cousins, du 8 mm, du 9,5 et même du 16 mm ! Lorsque ma mère est arrivée pour déjeuner avec moi, je lui ai annoncé que plus tard je ferai du cinéma.
Elle n’a pas bronché, il en fallait plus pour la déconcerter quand il s’agissait de moi. Elle est allée dans la librairie la plus proche, a fait part de ma vocation toute fraîche à la vendeuse et s’est retrouvée abonnée à la revue Avenirs qui, numéro après numéro, détaillait les formations, filières, débouchés et salaires possibles pour tel ou tel type de profession. Un an plus tard, un numéro consacré aux métiers du cinéma a été publié. Là, première chose, ma mère feuillette le journal, elle regarde les salaires escomptés, les sommes lui paraissent si énormes qu’elle appelle le magazine pour qu’il
pour qu’il corrige ces erreurs évidentes. On la détrompe, et la voilà encore plus embarrassée. Elle consulte ses amies qui toutes, à l’unisson, s’exclament : « Quel dommage, un si bon élève ! » Ma mère est tiraillée : quand on a la chance d’avoir un bon élève à la maison, on ne l’oriente pas vers des métiers incertains, qui, de toute façon, ne doivent pas être très honnêtes. Pour elle, tout cela sent le frelaté. Mais elle veut par-dessus tout me faire plaisir. Elle note donc le nom de l’école la plus prestigieuse, l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques), et, par téléphone, obtient un rendez-vous avec le directeur, Rémy Tessonneau.
L’IDHEC à 9 ans ?
Un jeudi matin, nous voilà partis. Je suis en culottes courtes et chaussettes, et je suis désespéré parce que l’élastique d’une de ces maudites chaussettes est détendu et qu’elle tombe. Je pense que cela fait très mauvais effet pour aller voir le directeur de l’IDHEC ! Quoi qu’il en soit, nous nous retrouvons aux Champs-Élysées, dans le bureau de ce fameux directeur. Il ne me regarde pas du tout et pose à ma mère quelques questions sur le thème « qu’est-ce qui incite votre fils à faire du cinéma ? ». Elle lui explique deux ou trois choses, il enregistre, et soudain demande l’âge de l’impétrant. Ma mère se tourne vers moi et dit : « Il a 9 ans. » Le directeur : « C’est lui qui veut faire du cinéma ? » Ma mère, impavide : « Oui, oui. Vous savez, il a de la suite dans les idées. » Énorme rire du directeur, qui appuie sur un bouton. Surgit derrière moi une dame à laquelle le directeur nous montre comme deux phénomènes. La dame m’interroge très gentiment. Elle s’appelait Mlle Nicolas et allait beaucoup compter dans ma vie.
Ma mère ne perçoit pas le cocasse de la situation et poursuit son enquête. Le directeur la prévient quand même que les étudiants sont pour la plupart des bacs +3 ou +4, ce qui ne l’impressionne absolument pas. Et lui précise : « Le cinéma est un mélange de littérature et de technique, d’art et d’industrie. Il faut donc qu’il fasse des études littéraires et scientifiques. — Très bien », dit ma mère qui prend tout en sténo. M. Tessonneau recommande un bac A’ (latin, grec) suivi d’une année de mathématiques élémentaires, puis de l’école de Vaugirard avant de me présenter à l’IDHEC. Le programme sera suivi à la lettre.