
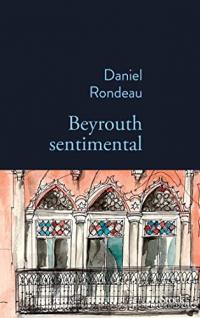
J ’ai posé mon front sur le cœur du pays du Cèdre et je vis avec les pulsations de Beyrouth dans la tête. Depuis toujours. J’ai rencontré des savants, des miliciens, des prêtres, deux divas, quatre présidents, deux béatitudes, des vagabonds, des émirs, des pêcheurs, des milliardaires, des généraux, un blindeur de voitures, un armateur, des poètes, des moines, des soldats, un joaillier, une infirmière, une étudiante, des avocats, des écrivains, des barmen de rooftop, une braqueuse de banque, un ancien de la France libre, des archéologues, des Antigone blondes ou brunes, des libraires, une éditrice, un décorateur, des gens ordinaires, quelques saints, peut-être. Leur concert a fait la gloire d’un pays opulent qui fut un morceau de Bethléem mais où tous les diables de la planète semblent s’être donné rendez-vous. Sans parler des réfugiés syriens que notre Europe disloquée continue de leur assigner, dans sa tranchante inconscience. Beyrouth sentimental dessine le visage d’un peuple hanté par l’amour et par ses morts, qui a plus que jamais faim de liberté et de fantaisie, toujours gourmand du miel de la vie, mais que, pour la première fois, j’ai saisi en flagrant délit de désespérance. Tous ceux que j’aime attendent le réveil de la lumière. Sabah al nour !
*
J’ai toujours entendu Beyrouth me parler. Une ville qui vous parle et vous appelle, c’est possible ? J’étais enfant, j’avais ma petite niche dans la craie de mon village. Et je pouvais piocher à ma guise dans un filon inépuisable de livres à la bibliothèque de Chalons. Lire c’est toujours vivre d’autres vies que la sienne. Je lisais. L’Orient vivait en moi, comme il avait vécu chez ceux qui m’avaient précédé, pauvres vignerons ou laboureurs qui ne savaient pas grand-chose ni du monde ni de leur temps, mais qui avaient confié leurs tourments à la consolation d’une tradition sacrée venue du très lointain. Sur l’atlas de la Terra sancta, il y avait le Liban. Beyrouth m’appelait.
Au fil de ces années d’enfance, enchaîné à ma terre natale et à son ciel, à ses brumes et à son soleil, mais la tête dans divers lointains, les livres ont continué à me raconter le Liban. Certains journaux aussi, avec des photos en noir en blanc. Sur un exemplaire de Paris Match, une histoire s’animait. J’avais dix ans. Je découvrais Baalbek, ancienne capitale du soleil du monde romain, déployée autour de ses deux grandes artères, le decumanus et le cardo. Un président libanais, un certain Camille Chamoun, installait un festival dans les splendeurs des temples antiques. L’Orient se mélangeait à l’Occident, le passé rejoignait le présent.
*
Je me suis lancé en 1987. Mon avion était presque vide. Nous n’étions que deux passagers. Un prince français affairiste en classe affaires, ce qui est la moindre des choses. Pour ma part, j’étais à ma place, au fond de l’avion. Puis l’aéroport a fermé. Beyrouth vivait déjà des temps difficiles. Comme tout le monde, j’ai pris l’avion pour Chypre, puis un ferry, le Sunny Boat, pour Beyrouth. J’avais embarqué à Limassol. Le Liban commençait sur le bateau. La plupart des passagers étaient écroulés de fatigue dans les fauteuils du salon-bar à l’entrepont. Boiseries vernies, fauteuils avec des housses en tissu écossais. Des vieillards dormaient sur leurs valises. Des serveurs égyptiens servaient des whiskies sur des montagnes de glace. Un orchestre enchaînait des airs populaires. Personne ne dansait. Vers deux heures du matin, une fausse blonde en salopette kaki s’était emparée du micro. Quelques dormeurs ouvrirent un œil. Les musiciens accordèrent leurs instruments. Une rythmique orientale leur imprima un nouveau tempo. Un joueur de kanoun pinça les cordes de son instrument. Des notes s’envolèrent comme une nuée de colibris mélancoliques. La salle bascula. Vénus, c’est ainsi que l’artiste s’était présentée, commença son tour de chant. Ses bras ondulaient comme des serpents. Ses hanches obéissaient aux intonations de sa voix. Le titre de sa dernière chanson ? Loubnan, Liban. « Mon pays, notre pays, avait-elle dit, le pays que nous aimons. »
*
Je ne m’étais pas embarqué pour Beyrouth en chantant Adieu vieille Europe, que le diable t’emporte, même si je savais que j’y retrouverais peut-être des enfants du Crabe-Tambour. C’était mon vieux pays que je cherchais. J’avais besoin qu’il m’envoie des preuves de vie. Ayant achevé dix ans auparavant mon pèlerinage d’établissement dans des usines lorraines sur les rives de la Moselle, j’étais sorti de cette vallée riante et fumante qui m’avait donné ma provende de communions en ouvrant la focale des fraternités. En règle avec moi-même, je m’étais écarté sans que rien ne me sépare de ceux que je venais de quitter. J’avais assez vite parcouru l’une après l’autre les étapes d’une reconsidération intérieure qui brassait vœux (Littérature notre ciel !) et destin (questions sur la singularité d’être français et européen, origines et promesses).
*
Personne ne m’attendait quand je suis sorti du bassin numéro 5 du port de Jounieh, alors contrôlé par une milice chrétienne. J’ai marché quelques dizaines de mètres sur la petite route qui menait vers la ville, en cherchant un taxi. C’était un matin de soleil, j’avais laissé le froid derrière moi, à Paris. Je me suis retrouvé dans l’état incertain du voyageur qui arrive en terre aimée et inconnue, peut-être dangereuse. J’avais peu dormi pendant la traversée, j’avais veillé pour Vénus, puis je m’étais levé tôt pour ne pas rater l’apparition de la côte. J’y tenais, à ce premier regard sur un pays qui m’avait appelé. La mer avait fraîchi et jetait des paquets d’eau jusqu’à la timonerie. La lente avancée du bateau me rapprochait inexorablement du Liban. J’étais à la fois fatigué, excité et sur mes gardes. Le chauffeur de taxi m’avait dit : « Vous êtes français, bienvenue au Liban », et il avait branché sa radio sur une station francophone qui diffusait des chansons de France Gall et de Michel Sardou. Je regardais par la vitre, tout autour de moi. Je voyais des maisons, des bouquets de palmes, des bâtisses carrées, en pierre blonde, avec des balustres de fer, en assez piteux état.
Le taxi m’a conduit à l’hôtel Dallas de Jounieh, un établissement modeste, avec un patio intérieur. Une femme est entrée en même temps que moi dans le hall, avec son fils. Le portier lui a parlé, sans faire attention à moi. J’ai compris qu’elle était une amie du directeur. Pendant qu’elle parlait, son fils sautait à pieds joints sur les deux canapés de l’entrée. Il est tombé en renversant un faux vase de Chine, fabriqué dans une matière qui résistait aux chocs. Sa mère l’a réprimandé de loin, sans interrompre sa conversation. L’enfant s’est sauvé dans la rue et est revenu avec une mitraillette en plastique. Il a braqué l’arme factice vers sa mère en hurlant : « Je te tue. Taratatata ! » Il a aussi rafalé le portier mais m’a épargné. L’employé de l’accueil m’a alors demandé mon passeport et m’a attribué une chambre au deuxième étage. Je suis monté seul, personne ne m’a accompagné. En arrivant dans ma chambre, j’ai regardé sous le lit, derrière les rideaux, dans le placard, et j’ai inspecté le minuscule balcon. Je voulais m’assurer que celui qui aurait pu avoir l’intention de me liquider ou de m’enlever n’était pas arrivé avant moi. Voilà comment je me suis retrouvé au Liban. Le lendemain, un jeune dentiste m’attendait. Il a traversé le hall d’un pas de sénateur, s’est présenté, « Khalil Karam », en me donnant sa carte, il m’a offert un serre-papier en métal, une lourde piastre libanaise, puis il m’a proposé ses services de militant de la francophonie pour m’aider dans mes projets de conférence pour maintenir une présence française à Beyrouth.
*
L’insécurité compromettait la vie du pays, les enlèvements étaient quotidiens, plusieurs Français retenus en otage depuis des mois, je ne voulais pas prendre de risques. Ma valise déposée, je me suis jeté dans un taxi pour Beyrouth, par une route que je finirai par connaître par cœur et qui longe la mer. J’avais vite pris mes repères : la centrale de Zouc, les gorges de Nahr el Kelb, la rivière du Chien, les chalets de béton du complexe de Rimal (où j’aurais la jouissance d’un studio, avec un petit Beretta dans ma table de nuit, au cas où, mais la nuit, je ne me battrais que contre des moustiques), la Cigale, fameux magasin de cigares et ses montagnes de Montecristo aux noms de grands bordeaux, les garages Porsche et Mercedes, les étals en plein vent, avec des pyramides d’oranges, les marchands de pastèques et de galettes de pain, et les enfants pêcheurs, dans l’eau jusqu’au cou, qui tenaient leurs filets au-dessus de leurs têtes. Ils étaient plusieurs dizaines, abandonnés ou orphelins. Des cheveux comme des plumes de geai, des mèches querelleuses et raides, le teint cuivré. Au fil des semaines, j’ai eu le temps d’observer ces jeunes garçons résignés qui ressemblaient aux enfants mendiants de Goya. La nuit, pendant que leurs aînés pêchaient à la lampe, les plus jeunes s’asseyaient à croupetons autour d’un feu, sur la plage, et faisaient griller ce qu’ils avaient ramassé dans leurs filets. Un chapelet de néons pavoisait des kilomètres de villes nouvelles, bâties pour les réfugiés chrétiens venus du sud. Sur l’axe Jounieh-Beyrouth, le flot des voitures gonflait deux fois par jour. Des Range Rover ou de gros 4 × 4, où s’entassaient des hommes en armes, se ruaient dans les embouteillages. Les grosses cylindrées, parfois sans plaques d’immatriculation, étaient plus nombreuses qu’avenue Foch. »