
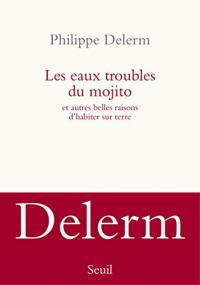
Découvrez le début du livre de Philippe Delerm qui n'est pa sans rappeler "La première gorgée de bière, et autres plaisirs minuscules":
Le mensonge de la pastèque
Elle est trop belle. Étrange. Est-ce qu’on la boit,
est-ce qu’on la mange ? Elle est comme une fausse
piste du désir. Le rouge-rose de cette chair meurtrie,
évanescente et gorgée d’eau, vient mourir en
pâleur maladive au bord de la solide écorce vert
profond. Au centre elle est si sombre, incrustée
de grains inquiétants d’un noir d’ébène, pépins
ou fers de lance empoisonnés.
Comment peut-on être si lourde de tant de rien
impudent, magnifi é ? Toujours ouverte sur les
marchés de l’été, la pastèque s’exhibe en recours
absolu contre une soif qui jamais ne s’étanche.
À quoi bon l’acheter ? On sent déjà qu’elle se
dissoudrait sur la langue, neige écarlate bien trop
tôt fondue. La mangue et la goyave ont goût de
goyave et de mangue. La pastèque n’a goût de rien,
et c’est donc elle qu’on désire en vain. Elle est la
perfection de son mensonge, et les marchands le
savent bien. Ils l’exposent à l’écart, et connaissent
son rôle. Elle allume tous les regards, conjugue
impudemment la moiteur, la fraîcheur, donne
un peu de son insaisissable perfection aux fruits
modestes qui l’entourent.
Elle se vend effrontément. On ne l’achète pas,
par peur du ridicule. On sait d’avance qu’on ne
pourra la posséder vraiment. Son goût est transparent.
Elle n’est qu’un mirage de la chaleur et
de l’été.
Ses lèvres bougent à peine
On est avec lui dans le bus. Enfin, avec lui…
Assis juste en face, il est ici, ailleurs, partout. Il
a sept ans. Cours élémentaire première année.
Cette année, il sait vraiment lire. Tout à l’heure,
à peine sorti de la librairie, il s’est emparé de ce
petit album d’Yvan Pommaux à la couverture bleu
lavande et il s’y est aussitôt embarqué, vaguement
conscient de la réalité qui l’entourait – évitant
les piétons un peu comme un skieur de slalom
ferait pour les piquets. Souvent, en le croisant les
gens souriaient, et on se sent plutôt fi er d’avoir
pour petit-fi ls un dévoreur de livres.
Maintenant, dans les soubresauts du trafic. On
le regarde dans sa bulle, si loin, si près. Ce qui
est fascinant, c’est l’imperceptible mouvement de
ses lèvres. Il ne fronce pas le front ni les sourcils.
Mais il ne glisse pas encore sans effort sur la piste.
Il lui faut ce déchiffrage pas tout à fait fl uide,
sublimé par l’envie, la passion, le désir émouvant
de posséder ce monde où il veut s’évader.
On est sûr que si on lui lisait cette histoire il
sourirait souvent. Mais il ne sourit pas. Son visage
est pénétré, si grave. Il crée ses propres terres
d’aventure, le secret silencieux de son éloignement.
Ses lèvres bougent. Il boit à petits coups
la magie difficile de l’échappée.
C’est un travail encore, et c’est déjà la liberté.
Il y a un code. On ne va pas le déranger avec un
« Ça te plaît, c’est bien ? ». On sait qu’il ne faut
pas brusquer l’embarquement des somnambules.
On ne veut pas non plus le ramener à la réalité,
la présence d’un grand-père avec son petit-fi ls
dans un autobus bondé de fi n d’après-midi. On
vole de le regarder voler. On ne l’a jamais trouvé
si beau. Ses lèvres bougent à peine.
Danser sans savoir danser
Dans les fêtes de province, pendant les vacances,
on faisait partie de ceux qui restaient rivés à la
table du café de plein air, en bout de piste. On
regardait les artistes du paso-doble et du rock and
roll. On admirait leur aisance, leur pouvoir. On
se sentait si amoureux, parce qu’on ne savait pas
danser. Plus tard, on était de ceux qui n’allaient
pas en boîte. Et puis voilà. La vie a passé. On se
retrouve à un mariage. En général, on trouve ça
ennuyeux, ces efforts de conversation avec les
cousins de la mariée qu’on ne reverra jamais. Alors
quand la musique s’installe, on choisit de danser.
Danser, c’est un grand mot. On bouge comme
un ours. Mais ce n’est pas grave. On a passé l’âge
des susceptibilités. Chance, ça commence par
un twist. On peut jouer sur son insuffisance en
deuxième degré, en pliant les genoux, avec un
mouvement des bras qui ne donne pas le change,
mais semble se moquer de toute une époque – la
nôtre. Le problème, c’est que juste à côté des
beaucoup plus jeunes maîtrisent idéalement le
twist, mais on n’est pas dans la compétition.
Une valse ! Là aussi, on peut tournicoter avec
un sourire ineffable. Alain Delon dans Le guépard. Mine de rien, on commence à se sentir
étrangement bien, on entre dans la peau des
personnages qu’on feint d’imiter. Peu à peu,
on oublie le regard des autres. On ne parodie
plus, le risque de ridicule semble s’effacer. On
se réconcilie avec son corps. On voit bien les
gestes parfaits de ceux qui ont la vraie technique.
Mais curieusement, on ne les envie pas. Ils ont
toujours su danser, sans doute, et ne connaissent
rien de la mélancolie de ne pas savoir. C’est
tout à fait bon de sentir que l’infériorité devient
supériorité. À ne pas savoir danser, on sacralise
la danse, on lui donne tout son pouvoir. Toutes
les années perdues en apparence font le bonheur
présent. Et l’on se venge enfin du carcan de
l’adolescence.