Tituba, Sethe, Zarité, Aibileen, Minny ou Eugenia… Parler de la discrimination raciale par la voix des femmes, voilà le choix de Maryse Condé, Toni Morrison, Isabel Allende, Kathryn Stockett (quatre romancières, femmes elles-aussi….). Comment comprendre ce choix du féminin qui caractérise ces œuvres sans pour autant les limiter ?
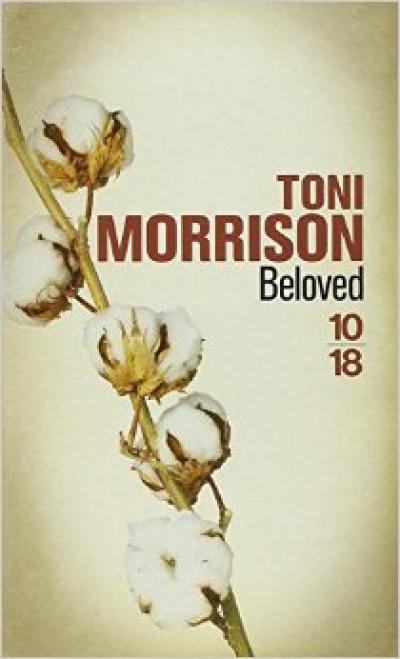

Moi, Tituba et Beloved paraissent respectivement en 1986 et 1987. A cette époque, les gender studies se développent aux Etats-Unis : il s’agit d’un mouvement de pensée cherchant à réévaluer la place du genre dans la société et la littérature. L’île aux esclaves et La Couleur des sentiments sont des romans plus récents (2009 et 2011) mais ils mettent en avant les mêmes réflexions, portées par des héroïnes aussi courageuses qu’attachantes.
Etre femme est en soi une position identitaire particulière. Dans des sociétés sexistes et patriarcales, la femme ne dispose pas des mêmes droits que l’homme. Moi, Tituba se déroule au XVIIème siècle, L'île sous la mer au XVIIIème et Beloved au XIXème. Femmes blanches comme noires sont unies dans une discrimination par le genre. Dans La Couleur des sentiments, Kathryn Stockett nous plonge dans l’Amérique des années 1960, où la femme est encore loin d’être l’égale de l’homme. Eugenia Skeeter, blanche et issue d’une famille aisée, aura tout le loisir de s’en rendre compte... Se marier, participer à des réunions mondaines, au mieux, être secrétaire : voilà tout ce qu’elle est en droit d’espérer.
Mais être femme noire complique encore la donne. A la discrimination par le genre s’ajoute celle par la couleur. Dans des systèmes esclavagistes ou ségrégationnistes, la femme noire se trouve reléguée au bas de l’échelle sociale, ou plutôt de l’échelle humaine… Elle n’existe que par ce que l’on peut tirer d’elle : du travail, du plaisir.
Cependant, les romancières ne cherchent pas à nous dépeindre uniquement des victimes. Il s’agit plutôt de montrer la façon particulière qu’ont les femmes de vivre la violence de leur société et surtout les ressources particulières qu’elles peuvent mettre en place pour résister.
L’esclavage et la maternité semblent être deux réalités inconciliables. Les mères esclaves sont confrontées à des situations toutes plus terribles les unes que les autres. Il y a celles qui voient mourir leur nourrisson, incapables de résister à la dure vie sur les plantations ; celles qui sont séparées de leur enfant, vendu à un autre maître ; celles qui donnent naissance à des enfants issus de viol. Certaines femmes ne peuvent se résoudre à faire naître un enfant dans un monde fait de coups de fouet, d’humiliations, de travail forcé. Alors elles avortent, avec les moyens du bord. Et si cela ne fonctionne pas, elles tuent. Acte radical qui marginalise la femme et en fait un monstre aux yeux des autres. C’est cette image d’elle-même que devra affronter Sethe, l’héroïne de Beloved…
Chez Stockett, le traitement de la maternité diffère car l’intrigue ne se déroule pas pendant une période esclavagiste. Mais elle reste tout de même centrale : les nourrices noires passent leur temps à s’occuper des enfants de leur maîtresse, devenant des mères de substitution pour les enfants blancs, et des mères absentes pour leurs propres enfants....
Chez Allende, Morrison et Condé, les femmes sont naturellement portées vers la magie. Tituba a des pouvoirs de guérisseuse et sait communiquer avec les esprits. Sethe développe une relation étroite avec le fantôme de sa fille. Quant à Zarité, elle reste très proche des « loas », les divinités vaudoues.
Ce lien au spirituel n’est pas bien accueilli dans les pays esclavagistes. La femme noire est vue comme une sorcière, dangereuse, pratiquant la magie noire. Les Blancs ont peur de cette culture ancestrale issue d’Afrique. Mais comment réprimer une tradition qui se transmet oralement, par les contes, les légendes, les chants ? Impossible… La culture africaine reste vivace, se transforme en se mêlant à celle du nouveau pays, formant ainsi un métissage riche et précieux dont les romans se font les porte-parole.

Dans le titre, tout semble être dit ! Le personnage, sa situation, le lieu, l’époque…On voit d’emblée la forme d’écriture qui sera celle du roman : frontale, sans fioritures ni détours. Un style surprenant qui illustre bien l’esprit de l’auteure guadeloupéenne, entre provocation et ironie…
Pour écrire son roman, Maryse Condé s’est inspirée d’un personnage réel : Tituba, esclave amérindienne accusée de sorcellerie lors des célèbres Procès de Salem à la fin du XVIIème siècle. A partir de sa vie, dont on ne connaît que quelques bribes, la romancière imagine le parcours de cette esclave pas comme les autres.
La première partie du roman se déroule à La Barbade, une colonie anglaise. La vie sur les plantations est difficile et Tituba doit supporter brimades et humiliations. Mais alors qu’elle se cache dans une cabane au fond de la forêt, elle rencontre une vieille femme guérisseuse… Celle-ci lui transmet son savoir : pouvoirs des plantes et communication avec les « Invisibles », les esprits des morts… Voilà pour Tituba le moyen de retrouver sa mère, pendue pour avoir résisté à la tentative de viol d’un maître blanc… Tituba devient donc une sorcière : elle a trouvé son rôle et son identité profonde. Si elle voit la sorcière comme un être utile et bienveillant, elle n’aura que le loisir de se rendre compte que les Blancs ne sont pas de cet avis… Obligée de suivre son maître en Amérique, à Boston puis à Salem, Tituba ne tarde pas à être accusée de sorcellerie et jetée en prison, en attente de son procès. Les Procès de Salem, ce sont trois cents accusées, vingt-cinq condamnées à mort. Véritable témoignage de l’hystérie et de la paranoïa puritaines, ils restent aujourd’hui tristement célèbres. Tituba devra faire preuve de ruse et de courage pour échapper à la folie collective et espérer retrouver un jour sa chère Barbade. Et là peut-être pourra-t-elle vivre en paix, en conciliant tous les aspects de son identité : une femme, une mère, une guérisseuse…
Dans son roman, Condé dénonce l’injustice de l’Histoire, écrite toujours unilatéralement par les « vainqueurs ». Ainsi, Tituba note que beaucoup d’éléments ont été gardés dans les archives concernant les sorcières blanches mais qu’a-t-on conservé de son histoire à elle ? Presque rien, si ce n’est « quelques lignes dans d’épais traités ». Condé cherche à combler ces lacunes par la fiction en redonnant une place et une voix aux oublié(e)s de l’Histoire.
Cependant, l’auteur refuse de tomber dans un « complexe de victime », comme elle l’explique dans un entretien accordé à Françoise Pfaff en 1993. Si son propos est grave, elle cherche toujours à le dédramatiser par l’humour. Ainsi, le lecteur est souvent amené à rire de Tituba. Elle tombe sans cesse amoureuse et possède une sensualité exacerbée, ne pouvant lutter contre son attirance pour les hommes… Elle apparaît comme l’incarnation des clichés véhiculés par les Blancs sur la féminité noire. De plus, Condé n’hésite pas à utiliser des anachronismes dans son roman comme le prouvent les nombreuses références à la série télévisée américaine Ma sorcière bien-aimée ! Effets de décalage comiques qui illustrent bien l’état d’esprit de Maryse Condé : « la réalité du monde noir est tellement triste que si on en rit pas un peu, on devient complètement désespéré et négatif ».
Beloved est le cinquième roman de la célèbre romancière afro-américaine, roman qui lui a valu le prix Pulitzer en 1988.
Sethe, esclave dans la plantation du Bon-Abri, est épuisée par les mauvais traitements de Maître d’Ecole, le régisseur. Son but : rejoindre Baby Suggs, sa belle-mère, chez qui elle a déjà envoyé ses trois enfants. C’est enceinte de son quatrième enfant, et le dos meurtri par les coups de fouet, qu’elle prend la fuite. Sur le chemin, grâce à l’aide providentielle d’une jeune fille blanche, elle donne naissance à Denver. Arrivée chez Baby Suggs, elle n’a que peu de temps pour goûter le bonheur d’être auprès de sa famille car les maîtres blancs ne tardent pas à la retrouver. Acculée, Sethe commet l’impensable, peut-être l’irréparable... Elle tue sa fille avec une scie. Si on ne l’avait pas arrêtée, c’est tous ses enfants qu’elle aurait assassinés, incapable de les voir entre les mains de ses bourreaux.
En 1870, l’esclavage est aboli. Cependant, Sethe est condamnée à une autre forme d’emprisonnement : cloîtrée avec Denver dans la maison du 124, elle est rejetée par les membres du village et terrifiée par le fantôme colérique de sa fille revenu hanter la maison… Mais un jour, une jeune fille mystérieuse vient frapper à la porte. Elle s’appelle Beloved et témoigne d’une étrange affection pour Sethe... Sous les yeux inquiets de Denver se noue une relation ambiguë entre Sethe et Beloved, faite d’amour et de haine. Une relation de laquelle une seule pourra sortir vivante…
La narration se fait à la troisième personne mais le point de vue est interne : le lecteur passe successivement dans la conscience de chacun des personnages principaux, ayant accès à leurs pensées, leurs sensations, leurs souvenirs…C’est la technique du « stream of consciousness » (« le flux de conscience »), utilisée par Virginia Woolf par exemple. Grâce à ce mode de narration, les voix s’entrecroisent avec naturel et fluidité. C’est ce qui fait la beauté et aussi la complexité du roman. En effet, il faut parfois quelques lignes avant que le lecteur puisse réattribuer la parole au bon personnage. Mais Morrison prend garde à ne pas nous perdre. Chaque voix reste reconnaissable car elle a sa propre modulation : celle de Sethe est fragile comme un murmure ; celle de Baby Suggs est intense et profonde ; celle de Beloved est balbutiante et énigmatique ; quant à Denver, sa voix opère un crescendo, passant du chuchotement de l’enfant apeuré au véritable cri de révolte… Dans ce roman musical et polyphonique, chaque voix résonne seule, formant une ligne mélodique autonome, mais se fond aussi dans un chœur, une harmonie collective. Car c’est bien un des apprentissages que fera Sethe : son salut, elle ne le trouvera qu’en réintégrant la communauté. Dans Beloved, comme dans les autres romans de Morrison, le groupe a un rôle essentiel. Garant d’une tradition et d’une mémoire, il donne à l’individu un ancrage sans lequel il serait seul et impuissant. En particulier pour ces esclaves déracinés de leur pays et coupés de leur culture d’origine… En faisant résonner « la voix silencieuse » des femmes, Morrison tente de reformer cette collectivité démembrée.

Des quatre romans, c’est celui d’Isabel Allende, la nièce du célèbre président chilien, qui possède l’arrière-plan historique le plus développé. Le lecteur est amené à découvrir l’histoire chaotique et sanglante de Saint-Domingue, future Haïti. Au cours du XVIIIème, la colonie, partagée entre les Français et les Espagnols, s'est imposée comme la plus riche du monde. La culture de la canne à sucre fait la richesse des colons mais seulement au prix du travail forcé des esclaves. Leur révolte commence dès 1791 avec la célèbre cérémonie du Bois-Caïman que l’on trouve contée dans le roman. Après une cérémonie vaudoue orchestrée par le sorcier Boukman, le massacre a lieu : les plantations sont incendiées, les maîtres empoisonnés, femmes et enfants compris. Les esclaves, en supériorité numérique, parviennent à prendre l’ascendant. Toussaint Louverture, l’un des premiers chefs de la rébellion, prend le pouvoir. Mais la route est encore longue pour que Saint-Domingue, devenue Haïti en 1803, trouve un équilibre…
C’est sur cet arrière-plan que se dessine le parcours de Zarité, jeune esclave venue d’Afrique. Elle est encore enfant quand elle est achetée pour servir de femme de chambre sur la plantation Saint-Lazare. La première description de l’héroïne est symbolique : apeurée, la fillette tient contre serrée contre elle la poupée d’Erzulie, loa de l’amour et de la maternité. Les loas, ces divinités de la religion vaudoue, guideront Zarité tout au long de sa vie.
L’enfant rejoint donc la propriété de Toulouse Valmorain, un jeune français fraichement débarqué à Saint-Domingue pour reprendre la plantation à la suite de son père. L’esclave et le maître vont découvrir ensemble l’univers de la plantation : le climat étouffant, la poussière, la violence… Et la menace de cette révolte qui gronde. Des animaux sont empoisonnés, des chants vaudous s’élèvent des cases des esclaves la nuit venue, des rumeurs étranges circulent… Comme cet esclave nommé Mackandal qui aurait la capacité de se transformer en animal… Même s’ils méprisent les croyances primitives des esclaves, les Blancs tremblent. Eugenia, l’épouse de Valmorain, sombre peu à peu dans la folie. C’est donc à Zarité que revient la garde de son fils, Maurice. Puis l’arrivée de Rosette, petite fille issue du viol de Zarité par Valmorain, agrandira la « famille ». Mais quelle étrange famille ! Maurice pense que Rosette est sa sœur et que Zarité est sa mère. Valmorain est bien le père de Rosette mais ne peut pas la reconnaître. Zarité n’est pas la mère de Maurice et pourtant l’aime comme son fils. Des liens distendus, des liens contestés, des liens interdits… Mais des liens pourtant.
Une des forces du roman d’Allende, c’est d’échapper à tout manichéisme. Certains Blancs sont bons et éclairés, comme le Docteur Parmentier qui s’oppose fermement au système esclavagiste. Blancs et Noirs peuvent être heureux ensemble et certains trouvent le courage d’officialiser des unions mixtes. La relation centrale entre Zarité et Valmorain est elle-même complexe et riche en nuances. Les deux sont ennemis et pourtant ils vont être amenés à s’entraider. Même dans un système inhumain, l’humanité et l’amour ont leur place. Les sentiments, comme l’Histoire, sont complexes et rien ne peut être défini une fois pour toutes. Isabel Allende nous encourage à ne pas voir le monde en noir et blanc, dans tous les sens du terme.

Jackson, Mississipi, dans les années 60. L’esclavage est aboli depuis près d’un siècle mais les inégalités raciales perdurent. La politique est ségrégationniste, les mentalités racistes, surtout dans cet Etat du Sud, berceau de l’esclavagisme et réputé comme étant l’un des plus dur en matière de ségrégation. A Jackson, les femmes noires n’ont pas beaucoup de perspectives, étant toutes engagées comme bonnes par les familles blanches. Toute la journée, elles cuisinent, briquent les parquets, font briller l’argenterie… Et surtout, elles s’occupent des enfants : elles leur apportent tendresse et amour, assurent leur éducation, veillent à leur santé. Véritables mères de substitution, elles éclipsent même parfois la mère biologique.
Dans La Couleur des Sentiments, la parole est partagée entre trois femmes, de conditions, d’âges et de caractères bien différents. Il y a Aibileen, douce et réfléchie, qui comble la perte de son fils par son dévouement à la petite Mae Mobley, la fillette qu’elle garde chez les Leefolt. Il y a Minny, une autre bonne au langage fleuri et à la langue bien pendue, qui se distingue par ses talents de cuisinière. Engagée chez la blonde et fantasque Celia, elle découvrira que tous les Blancs ne sont pas à mettre dans le même panier… Et il y a Eugenia Skeeter, jeune femme blanche qui revient à Jackson après quatre ans d’études à l’université. C’est sous un nouveau jour qu’elle redécouvre la ville et ses habitants. Ses anciennes amies lui paraissent mesquines et frivoles : installer dans chaque maison des toilettes indépendantes pour les bonnes : voilà leur unique cheval de bataille. Quant à ses parents, ils ne la comprennent plus : pourquoi aller travailler dans un petit journal local, pour tenir une chronique sans intérêt sur l’art ménager, alors qu’elle devrait seulement penser à trouver un bon parti ?
Mais Eugenia ne peut se résoudre à la place qu’on réserve aux femmes dans cette société étriquée. Et encore moins à celle qu’on réserve aux femmes noires. Elle-même a été élevée par une bonne, Constantine, qui a disparu mystérieusement mais pour qui elle garde un amour quasi filial. Eugenia part donc à la rencontre de ces femmes qui travaillent dans l’ombre. Persuadée qu’elles ont beaucoup à dire, elle doit trouver un moyen de leur donner la parole.
Kathryn Stockett a vu le manuscrit de son roman refusé par soixante agents littéraires avant d’être enfin publié en 2009, par Amy Einhorn Books. Aujourd’hui, ce sont sept millions d’exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. Et ce succès n’est pas étonnant : l’écriture est vive, l’intrigue habilement ficelée, les personnages bien campés. La narration à trois voix permet de mettre en parallèle différents points de vue et de faire entrer en écho différents langages. Cette forme correspond bien au fond du roman qui raconte la collaboration de femmes toutes différentes mais unies dans un même combat : s’élever contre la ségrégation et dénoncer la bêtise humaine. La bêtise, voilà bien une des cibles de la Couleur des sentiments : comment ne pas rire de ces femmes bien rangées et bien pensantes, de Miss Leefolt à Miss Hilly, qui se révèlent toutes aussi stupides que méchantes ? Pour les ridiculiser, Stockett n’hésite pas utiliser l’humour et la caricature. Les situations cocasses et triviales se succèdent, au plus grand plaisir du lecteur… Au final, toutes les armes sont bonnes pour lutter contre le racisme : du projet d’écriture d’Eugenia à la tarte au chocolat de Minny… En quoi un simple dessert peut servir de revendication politique ? La réponse est dans ces quelques six-cents pages que vous dévorerez avec… délectation !
Les 9e Nuits de la lecture, organisées pour la quatrième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Cultu
Le jury du Grand Prix RTL - Lire Magazine 2025 vient de donner la liste des cinq romans sélectionnés.
Depuis 2014, le Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême est attribué à la suite d’un vote de la communauté des autric
 01
01
 03
03
 05
05