Gilles Leroy vient de publier "Zola Jackson". Cet amoureux de la vie, des grands espaces de peinture mais aussi de musique nous fait partager ses passions et ses questionnements au fil de ses romans. Autant de regards vers l'ailleurs où se déploie une sensibilté raffinée et lumineuse.
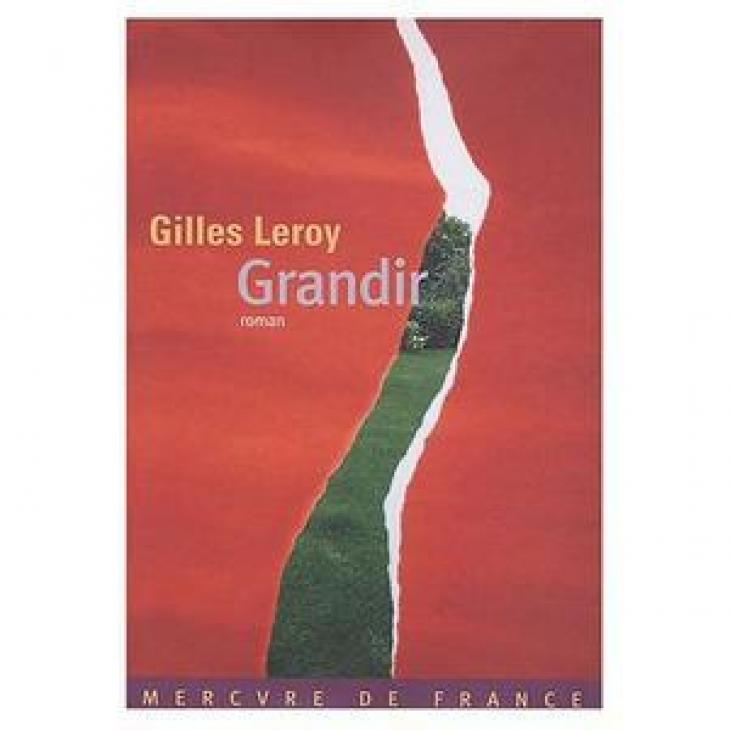
G.L: J’ai eu du mal les premiers temps à parler de ce roman. D’abord, je crois que j’étais fatigué : j’ai fini la tournée étrangère d’Alabama Song en novembre 2009 et, quinze jours plus tard, je commençais la promotion de Zola Jackson en France. Je n’avais pas mesuré ma fatigue.
Ensuite, il y a que c’est un roman qui ne se laisse pas réduire à un « pitch », qui ne se résume pas en quelques phrases. L’oral des interviews me donne parfois l’impression que j’abîme mes écrits. Surtout lorsque le roman a soulevé en moi tant d’émotions et ravivé tant de souvenirs. C’est la première fois que j’écrivais un roman dont j’aimais tous les personnages. Je les aimais jusqu’à pleurer pour eux en écrivant. Dès lors, les plateaux de télévision vous font un drôle d’effet. Un sentiment de déréalité.
G.L: On vit mieux, matériellement parlant. J’ai retrouvé le goût des voyages, des rencontres, une certaine mobilité que j’avais perdue au fil des ans - faute de moyens, tout simplement.
G.L: Je venais de publier mon deuxième livre, Maman est morte, qui n’était pas franchement un succès, lorsque Simone Gallimard, alertée par son directeur littéraire Nicolas Bréhal, m’a proposé que nous nous rencontrions. Je suis allé au rendez-vous sans grande illusion car j’écrivais alors un recueil de nouvelles et les éditeurs ne sont guères enclins à publier des nouvelles, surtout d’un jeune inconnu. Mais Simone m’a dit tout de go qu’elle aimait les nouvelles, qu’elle avait envie de faire des livres avec moi, et ce fut le début de l’aventure entre le Mercure et moi.
G.L: Oui, plusieurs éditeurs nord-américains ont eu peur du sujet, semble-t-il. Mais ce n’est pas fini. J’ai une nouvelle agente là-bas qui a repris les choses en main et y croit. Enfin, en matière de culture, le protectionnisme des Etats-uniens n’a d’égal que leur impérialisme.
G.L: Oui, c’est exactement ça.
G.L: Parce que je suis né d’une femme ! Et, depuis l’enfance, mes plus grandes leçons de vie me sont venues des femmes.
G.L: Pour la liberté, le désir, l’énergie. Pour ce moment aussi où les frontières tombent entre les arts. Le New York et, surtout, le Paris de l’époque sont de grands viviers de talents, des lieux électriques. Le maître mot de ces années, c’est émancipation. Dans les mœurs comme dans les arts.
G.L:Ils nous font revenir à plus de modestie, plus de tempérance. La nature compte pour moi, plusieurs de mes livres la mettent en scène, souvent dans ses excès et ses menaces. Je vis entouré de champs et de bois. Tôt le matin, je tombe nez à nez avec des biches ou des chevreuils. J’aime ça. J’ai l’impression d’être meilleur dans ces instants-là.
G.L:C’est mon héritage paternel. Mon jeune père était fou de l’Amérique, et il y allait assez souvent pour son métier (il importait de Chicago des machines à sous et autres juke-boxs, flippers). Il adorait Kennedy, James Dean, Elvis Presley. Plus tard, j’ai eu mon propre rapport à l’Amérique en découvrant une littérature qui allait changer radicalement ma perception du monde : Faulkner, Carson McCullers, Truman Capote, Dos Passos, Steinbeck et, bien sûr, Fitzgerald.
G.L: Oh, elle est là, présente, elle est un fait. Est-elle acceptée pour autant ? Pas vraiment. Mon expérience personnelle m’a fait réfléchir à la différence et , notamment, à ce qu’on appelle les couples mixtes (comme si tout couple n’était pas nécessairement mixte, la rencontre de deux corps, de deux histoires…) Il faut avoir subi les regards de travers, certains salaces, d’autres méprisants, pour comprendre le rejet de ces couples aujourd’hui encore.
G.L: Non, je ne suis pas musicien et plutôt autodidacte en la matière. La musique accompagne ma vie chaque jour, surtout quand j’écris. Je ne peux pas écrire dans le silence, et encore moins dans le bruit. La musique, la vraie, est une expérience au-delà du silence et du bruit.
G.L: Surtout pas en opposition ! Des ponts, c’est cela qu’il faut jeter entre les disciplines. Il y a deux ans, j’étais à Montpellier avec deux amis de la région, nous sommes allés au musée Fabre où un étage entier est consacré à Soulages. J’étais abasourdi. Nous l’étions tous les trois, je crois, au point que nous sommes restés sur un canapé pendant presque une heure, sidérés, à regarder une toile géante entièrement noire. J’aurais tant aimé peindre, avoir ce talent.
G.L: Je ne crains pas les mots mais parfois je suis fatigué de leur tyrannie. Henri Michaux parlait magnifiquement de cela – et c’est pour échapper à cette tyrannie qu’il peignait, justement.
La notion de brouillon m’est totalement étrangère. J’ai plusieurs amis romanciers qui écrivent un premier jet à la main, sur un cahier, puis le recopient sur ordinateur, corrigeant alors. Moi, je déteste écrire à la main. Dès que j’ai voulu écrire - j’avais seize ans -, je me suis procuré une machine à écrire. Et dès que les traitements de texte sont apparus, je m’en suis offert un.
G.L: Vous avez raison, l’espace est essentiel chez moi, au point que beaucoup de mes textes partent d’un lieu qui, plus qu’un simple cadre, prend une fonction dynamique de protagoniste. C’était le cas du cinéma dans Madame X., le cas du lycée dans Les maîtres du monde, le cas du parc dans Les Jardins publics, le cas de la cristallerie dans Grandir.
G.L: De chair et de sang, de Michael Cunningham.
Le dernier grand livre était Blonde, de Joyce Carol Oates. Le premier livre qui fut un choc, c’était Le Rouge et le Noir – je n’avais que 11 ans, je n’ai sans doute pas tout compris, mais j’étais émerveillé.
G.L: J’aime ça très moyennement. Le plus dur, c’est de quitter ma maison, d’appeler le taxi, de prendre le premier train. Une fois sur place, en général je m’accommode de la situation. En 2008 et 2009, je passais tellement peu de temps chez moi que je ne défaisais plus ma valise entre deux voyages. Je ne la montais même pas dans ma chambre. Elle restait là, dans l’entrée, près de la porte.
Cette fois, nous avons limité les déplacements, du moins en France. Mais je pars d’ici quelques jours pour l’Italie où je fais cinq villes en six jours. Dans chaque ville, je rencontrerai un auteur italien différent : l’exercice m’intéresse.
G.L: La poésie, sans doute. Les autres genres, je crois les avoir explorés, sauf l’essai. J’aime lire des essais et me sens incapable d’en écrire. Je tiens à cette liberté du romancier de n’être pas forcément un intellectuel. Le statut d’intellectuel m’aurait beaucoup ennuyé – mais j’aime être entouré de gens qui réfléchissent, qui ne lâchent pas, qui m’éclairent pas leur réflexion tandis que, dans une belle réciprocité, une émulation peut-être, mes fictions leur montrent autre chose.
Gilles Leroy, Zola Jackson, Mercure de France
Site internet de Gilles Leroy

Le Festival de la BD d'Angoulême vient de se terminer. Voici l'ensemble du palmarès.
« Deux Filles Nues » de Luz reçoit le Fauve d'or du meilleur album au FIBD Angoulême.
Après Posy Simmonds en 2024, c’est Anouk Ricard qui est élue par ses pairs Grand Prix de la 52ᵉ édition du Festival International de la Bande Dessi
 01
01
 02
02
 05
05