Nous avons tous entendu parler de la censure pour atteinte aux bonnes mœurs de Madame Bovary de Flaubert ou des Fleurs du mal de Baudelaire. C’était en 1857. Depuis, le recueil de Baudelaire a été réhabilité et Madame Bovary ne fait plus rougir personne. Si ces interdictions ne sont plus aujourd'hui qu'un mauvais souvenir, il convient de se demander quelle forme prend la censure aujourd'hui car le travail de l’éditeur reste toujours le même : défendre son auteur contre vents et marées.

On se souvient de l'exposition de la Bpi au Centre Pompidou qui invitait à explorer le monde de l’édition française et à voir comment celui-ci s’est depuis toujours heurté à l'ordre moral, politique, religieux et économique dans la diffusion des livres.Une histoire de la censure de 1945 à nos jours était mise à jour avec archives juridiques, archives d’éditeurs ou d’auteurs, éditions originales de livres, articles de presse et photographies.
Depuis la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, la question majeure qui se pose est : quel est le rapport de l’État à l’édition ? Cette loi témoigne d’une volonté évidente de contrôler et de moraliser la pensée selon un modèle unique. L’exposition rend ainsi hommage à des éditeurs tels que François Maspero et Jérôme Lindon, qui se sont engagés politiquement contre la guerre d’Algérie puis pour les revendications sociales de 1968, ou encore Régine Deforges et Claude Tchou pour n’en citer que quelques uns.
Un dispositif juridique complexe est mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec l’arrivée des premiers illustrés venus d’Amérique, qu’on estime susceptible de corrompre les jeunes. En 1949, une loi est votée sur les publications destinées à la jeunesse. Le Ministère de la Justice et des Libertés créé une Commission de surveillance et de contrôle chargée de vérifier que ces publications « ne comportent aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. »
Selon Jean-Mathieu Méon, cette loi, fondée sur les prétendus effets de la littérature sur la société, incite à l’autocensure. Il y a 
La bande dessinée, succédant aux albums illustrés, est la première visée par cette loi et à faire l’objet de plusieurs mesures coercitives. Si la bande dessinée est attaquée de façon aussi virulente, et notamment la BD de science-fiction, c’est parce qu’on lui reproche non seulement son contenu, jugé terrifiant, mais aussi sa forme visuelle. Le dessin serait "violent", les couleurs "criardes" et les onomatopées trop nombreuses. La Commission de contrôle parviendra à censurer Mandrake (1963), Fantask (1969) et Marvel (1971) malgré leur succès apparent. Avec l’apparition de la « BD adulte », la BD est petit à petit de moins en
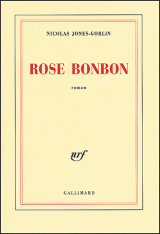
Pendant longtemps, l’État a censuré et interdit des livres. Aujourd’hui, les autorités publiques ont laissé la place à d’autres formes de censure : recours juridiques d’associations ou d’individus, pressions de la part de lobbys. Ainsi, en 2002, des associations de protection de l’enfance ont porté plainte pour tenter d’interdire la publication de Rose Bonbon, roman de Nicolas Jones-Gorlin mettant en scène un pédophile. Autres cas, Mathieu Lindon, auteur du Procès de Jean-Marie le Pen, une fiction politique où il exprime ses positions anti-Le Pen, est poursuivi pour diffamation. Ces réactions montrent, comme le dit la sociologue Gisèle Sapiro, la croyance persistante dans le pouvoir performatif des mots et des effets qui en découleraient.

Ces exemples nous montrent qu’il est nécessaire de rappeler, avec Agnès Tricoire, que « ce n’est pas la littérature qui fait les mœurs » et qu’une œuvre de fiction n’est pas à la recherche de la vérité mais du plaisir de la pensée et de la forme.
Emmanuel Pierrat (dir.), Le Livre noir de la censure, Seuil, 2008
Martine Poulain, « La Censure », Fouché Pascal (dir.), L’Édition française depuis 1945, Cercle de la librairie, 1998, p. 555-593.
Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain, Littérature, droit et morale (19e – 21e siècle), Seuil, 2011.
Agnès Tricoire, Petit traité de la liberté de création, La Découverte, 2011

« Deux Filles Nues » de Luz reçoit le Fauve d'or du meilleur album au FIBD Angoulême.
Après Posy Simmonds en 2024, c’est Anouk Ricard qui est élue par ses pairs Grand Prix de la 52ᵉ édition du Festival International de la Bande Dessi
 01
01
 03
03
 05
05