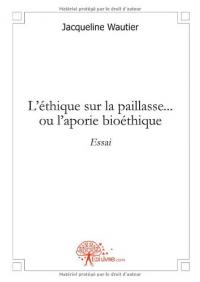
Le souci eugénique ou le progressisme génético-humaniste, comme la volonté Eugéniste, l’illusion clonale ou encore la tendance transhumaniste, reposent pour une part importante sur une croyance particulière eu égard au fonds génétique de l’individu : où le gène serait susceptible d’infléchir la nature quintessentielle de l’homme. Pourrait déterminer sa personnalité et construire une matrice propre au bonheur. Et encore, pacifier les relations humaines et harmoniser le substrat sociétal – pour le meilleur, conservant créativité jouissive ou porteuse et libre-arbitre pratique - en une perspective hyper déterministe où la liberté personnelle/personale n’existe pas ou pas vraiment.
A- Perspectives :
En ces positions et conceptions, l’abord est décisif : soit l’attention est portée sur le substrat, soit elle est portée sur son insertion dans un monde matériel, relationnel et affectif. Soit elle est portée sur la matière, soit elle est portée sur sa réappropriation. Portée sur le donné, ou sur son devenir pluri-déterminé. Sur le fait, ou sur la signifiance. Sur la vie phénoménale, ou sur l’existence signifiée. Choix, donc, du point jugé déterminant : là celui de l’incontournable matérialité de l’homme et des enchaînements de causalité, ici celui de l’alchimie, de l’équation plurielle des interférences. Cependant, selon les options privilégiées, les conclusions et développements opératoires (en matière de constructions personales, d’actions sociales ou culturelles, d’éthique et de liberté) diffèreront nécessairement.
B- La vie en équation… ↔oppo↔ …La vie en organisation :
(108) La vie résulte des propriétés duplicatives/réplicatives de l’ADN… ↔oppo↔ …La vie comme phénomène (ou métabolisme inscrit dans un devenir) est le fait d’une organisation hasardeuse, factuelle, fonctionnelle, reproductible : l’ADN est son matériau.
(109) La vie, l’organisation cellulaire, la spécialisation tissulaire, la structuration de l’encéphale et finalement la conscience produite par les communications, relations et boucles diverses des neurones relèvent, en leur développement comme en leur mode et fonctionnalité, de la traduction (protéique) d’un programme (moléculaire) : quels que soient les événements épigénétiques et environnementaux, ils portent toujours sur un donné initial déterminant un ensemble de possibilités ou de possibles pré-établis... ↔oppo↔ …La vie, l’organisation cellulaire, la spécialisation tissulaire, la structuration de l’encéphale et la conscience relèvent tous en en leur mode, fonctionnalité et signifiance d’une émergence : où la cellule ne résulte ni d’un plan ni d’un projet (de cellule) mais d’un ensemble d’interactions (moléculaires) locales ; où la structure complexe émerge d’un collectif ; où la forme se conforme d’un totalité contraignante[1]; où l’organisme s’organise d’une sociétalité (cellulaire) tandis que la pensée émerge des activités locales d’un groupe de neurones (soumis à un environnement et pris dans un ensemble d’interactions) – cf. R. Chandebois, M.-C. Maurel et P.-A. Miquel (sociétalité cellulaire), P. Sonigo et J.-J. Kupiec (sélection darwinienne), ou encore I. Stengers (notion d’émergence et d’occasion) : «une occasion ne résulte pas d’un plan, mais a besoin de quelqu’un qui la saisisse. Et ce quelqu’un est également transformé par ce qu’il saisit (…). / Un Dieu «amateur d’occasions», qui ne décide pas mais pour qui l’occasion seule importe, ne permettrait pas seulement de lutter contre le pouvoir attribué aux «causes» en biologie, mais pourrait aussi faire valoir d’autres manières de passer de l’histoire des vivants à l’histoire des humains.», R, n°14, 22-23.
(110) Le gène est le support de la vie… ↔oppo↔ …Le gène est une structure inerte : on ne peut saisir la vie dans l’inerte ; et pas plus le mouvement dans l’immobile, le devenir dans l’état, la multitude dans l’échantillon, la variance (ou la variabilité) dans une moyenne statistique – cf. P. Sonigo : «(…) l’hérédité est liée (…) à la reproductibilité de phénomènes aléatoires (…). Rien n’est transmis à proprement parler : les mêmes causes reproduisent les mêmes effets (…) Molécules et cellules sont autant de lancers de dés qui sous-tendent la reproductibilité que nous observons au niveau de l’organisme. (…) l’hérédité n’est pas écrite dans le dé, elle résulte du nombre de tirages. De la même façon, l’hérédité n’est pas écrite dans l’ADN. Elle résulte des tirages de la sélection naturelle.», NDNG, 194. Il s’agit conséquemment de se baser sur le complexe hasard-sélection quand celui-ci s’effectue dans un écosystème disposant d’une quantité de nourriture que les vivants (habitants, organites, organismes) devront pouvoir utiliser : «le résultat ne préexiste pas. Les transformations sont arrêtées par une cause (…) qui est sans rapport avec le résultat et pourrait stabiliser une autre forme. (…) Le modèle de hasard-sélection (…) privilégie la différence des êtres. Il nous dit que ce qui existe est le résultat temporaire du seul mouvement de la matière. (...) On découvre ainsi une autre théorie (…) dans laquelle la liberté remplace le déterminisme.», NDNG, 13-14
(111) L’unité de sélection n’est pas individuée/individuelle, mais proprement génique (ou chromosomique) - cf. P.-H. Gouyon, J.-P. Henry et J. Arnould soutenant que «Les individus sont des artifices que les gènes ont inventés pour se reproduire» - introduisant à chaque niveau (dans tous les processus et dans tous les comportements) le thème du conflit : entre génome nucléaire et génome cytoplasmique, entre segments ou séquences géniques (introns/exons/transposons) et entre gènes : «Le génome contiendrait même de nombreuses traces de conflits passés, en particulier sous la forme de séquences aujourd’hui «vaincues», empêchées de mettre en œuvre leur machinerie de multiplication, mais qui ne demanderaient qu’à s’exprimer à nouveau…», AduG… ↔oppo↔ …(JW) Les théories développées à partir d’un principe de sélection génique mésestiment l’inscription de la vie primitive dans la cohérence peu ou prou entitaire: à l’origine, ce n’est pas une information-matière qui se transmet, c’est un tout-structure qui assure la présence d’un autre tout-structure dans un moment futur où la source n’existera plus comme telle – et qui assure cette présence par propagation de support-structure (de gène) contraignant l’advenir et le devenir protéiques qui le contraignent en retour. Dans ces circonstances, l’individu n’est pas produit par les gènes en fonction d’une finalité génique (de transmission) mais l’organisme individué est tel en son organisation (structure réactive/réactionnelle) qu’il peut, de fait, assurer la continuité de sa forme opératoire - sachant qu’avec la conscience apparaîtra une organisation active.
(112) La vie en son émergence ignore tout de la Liberté – est même son autre dès lors que tout est réactions et réactivités chimiques. Elle est inscrite dans le mécanisme des lois physico-chimiques… ↔oppo↔ …La liberté naît avec et de la vie : celle-ci lui fournit (en son mode duplicatif soumis à l’erreur ou à la variation, en ses mutations ou en son devenir et son adaptabilité) ses conditions de possibilité qui s’actualiseront avec la conscience.
(JW) La Liberté relève d’une mise à distance (mise en représentations, en sens et en œuvre). Cependant, si sa majuscule (Liberté ou Idée-Liberté) est condition de possibilité d’une saisie opérante des latitudes ou occasions offertes par les minuscules (libertés, libre-arbitre, choix), c’est dans le métabolisme que ces dernières s’enracinent (dans son ouverture). C’est dans la réplication (mutation, changement, bifurcation et équilibration) qu’elles trouvent leur possible. C’est dans la transformation des substrats qu’elles se manifestent (leur propre substrat organique et le substrat nourricier). C’est dans la différenciation qu’elles se développent. Et les équilibres instables que l’homme vit, pressent et finalement découvre en son être avant de leur donner sens (intimité extériorisée et extériorité intériorisée, maintien et changement, matière et matière qui se fuit) trouvent leur possible dans les formes de vie primitives – dans le phénomène de la vie - cf. H. Jonas : «(…) c’est dans les sombres remous de la substance organique primitive qu’un principe de liberté luit pour la première fois à l’intérieur de la vaste nécessité de l’univers physique (…). Evidemment, il faut d’abord enlever toute connotation consciemment «mentale» au concept de liberté quand on en use à propos d’un principe si englobant : «liberté» doit désigner un mode d’être objectivement discernable, c’est-à-dire une manière de mettre en œuvre l’existence (…)», PdeV, 14-15[2]. Et liberté ou sentiment de liberté, comme aussi contingence et gratuité ontologiques, comme encore reconnaissance de l’Idée-liberté, sont fondamentaux au regard de l’engagement anthropique, de l’assomption de responsabilité, de la possibilité éthique et du choix existentiel – de la réalité personale, de la densité existentielle et de la signifiance individuelle. Comme le souligne A. Kahn, «Le sens moral germe sur le terreau du sentiment de liberté auquel conduit l’évidence d’un choix au sein d’une société humaine.», HceRP, 22
[1] De l’enroulement de la chromatine au repliement des protéines, du volume tissulaire à la segmentation antéro-postérieure : forces et pressions physiques, gradients protéiques, communications cellulaires, sources «nutritives»…
[2] Le soi en son origine est une entité qui se reçoit en ses modifications d’états ou d’équilibre : «l’esprit en germe», selon Jonas (ou, en un sens, le monde et son altérité en germe dans ce contact réactif préfigurant un devenir subjectif).